
C’est Antonin Besse qui va me permettre de dévider le dernier fil des écrits, fil d’Ariane, un fil retravaillé en fil de fer barbelé pour cette époque troublée ; saignez par toutes vos plaies, enkyster-vous la gorge à force d’hurler « au secours ! », guerres de religion, de conquêtes.
Est-il apaisant de penser à un soupçon d’espoir en visionnant les images rares des rares touristes séjournant sur l’Ile de Socotra, un paradis, calme…perdu ? Les photos existent. Ile de Socotra, no man’s maritime, quelque part sur la route des Indes.À chacun son île, à chacun son rêve…

Le roi de la mer rouge, Antonin Besse, fut le premier à me répondre : « Cher ami, venez, on vous attend. Cela me fera grand plaisir de parler à un compatriote. Pour votre gouvernance, je me suis renseigné : vos recherches m’enchantent. Un voyage littéraire dans la Corne de l’Afrique, quel beau sujet. »
Qui était-il pour me dérober la porte de mon jardin secret ? Je savais que ce roi du pétrole avait une agence à Djibouti, une autre à Hodeida. Il avait le sens des affaires, bien sûr, et une personnalité complexe, parfois déroutante comme le suggérera l’écrivain Britannique Evelyn Vaugh.
En forme, maintenant, ragaillardi à l’idée d’avoir des amis, des lecteurs, et un éditeur. Rien n’avait tourné au désastre imprimé par mes détracteurs. La saison des soldes était terminée.
Ma suit-case pliée, je hélai un taxi, direction l’aéroport. Avanti !
L’aéroport international de Djibouti-Ambouli, situé au sud de la capitale de ce pays-confetti, est l’ancienne base aérienne militaire de Djibouti.
L’ancien camp Lemonnier, du temps des français, jouxtant le tarmac, est désormais la base de l’United states Navy. Les Américains sont partout (c’est plus fort qu’eux).
Je vais boire un café au Green Beans coffee, en attendant la douane.
On décolle, on surplombe la ville. Juste le temps de voir le toit du restaurant de la Mer Rouge où j’avais mes habitudes.
Dans le DC4 rafistolé, peu de passagers. La guerre n’encourage pas le tourisme.
Ce sont surtout des commerçants. Avec qui commercent-ils ?
Des montagnes de sacs plastiques bleu et blanc, très solides, remplis à ras bord, s’empilent sur les sièges vides. Une musique lancinante – un appel à la prière – est crachotée par des hauts parleurs à bout de souffle. Je m’endors, bercé par la voix du muezzin.
Je m’éveille alors que l’avion entreprend la descente.
Aden. Blanc de blanc. Du soleil, du blanc encore. Des maisons, des cubes, étagés, se tenant les uns aux autres. Le cratère et le port, désenclavé, vous accueillent.
Dans le taxi en maraude j’indique : « To M. Besse, Crater, on Aidrus Road, please ».

Besse. Le sésame à Aden, tout le monde le connaît.
Dans l’intérieur bleu du taxi, les parois, encollées de nattes, s’effilochent, l’ambiance est assurée par la radio qui passe – qui hurle – les succès de Bob Azzam., sans se soucier du code de la route, et à tombeau ouvert.
Bob Azzam…je me souviens.
Je l’ai connu à Alexandrie, son lieu de naissance. La famille habitait près du consulat.
Wadih Georges Azzam 1924 – 2004, commença sa carrière en Italie, en reprenant les succès de Marino Marini.
En Algérie il suscita l’intérêt de la colonie Française. Des radios s’emparèrent de ses chansons et en firent des succès qui allèrent crescendos.
Qui ne se rappelle, dans les années 1960, de « Ya Mustapha », Fais-moi du couscous chéri, « c’est écrit dans le ciel ».
À Oran, où j’avais séjourné quelque temps, sur les pas d’Albert Camus, je rencontrais Nicole Garcia qui animait les soirées du Belvédère, un club chic surplombant la mer.
Elle possédait tous les disques de ce chanteur qui, le succès le fuyant, termina sa carrière dans une boîte de nuit à Genève.
Guettant mon taxi je demandais : Bob Azzam ? Le conducteur fou – nous étions arrivés vivants – commença à me parler des pieds-noirs, des Harkis, de son père qui avait participé, comme interprète, aux accords d’Évian en 1962.
Ah ! Bob Azzam ! Les Français ! Toute une époque.
Il me parlait, parlait encore et encore quand mes pas me conduisaient dans la ville.
Besse habitait quartier du Cratere. Ce Cratere était un ancien volcan éteint.
Je devais passer avant, à la banque, faire la commission demandée par Abdallah Rosa, la filleule de Mogadiscio, une parente par la main gauche de Denis Lavant.
La transaction ne pouvait se faire qu’à Aden. Je trouvais facilement la National Bank of Yémen, déjà ouverte à cette heure matinale. C’était un établissement spécialisé dans les transferts wise internationaux, avec des taux de change Reuters défiant toute concurrence. La seule banque de la mer rouge à proposer ce service grâce à une connexion ultra rapide et performante (code BIC / SWIFT) directement relié au chairman, Jimmy Mallock, un peu gourou, de la Cité de Londres. Des bruits, des rumeurs inquiétants s’étaient répandus sur ce personnage, banquier brassant l’argent de la Corne de l’Afrique.
Vous êtes bien à Djibouti, et au Yémen, entre Afrique et Asie, des pays surchauffés où les affaires se colorent de corruption, de petits arrangements où la camarde se promène, d’une rive à l’autre.
Les guerres de religion ont remplacé le temps des colonies.
Vous êtes dans un récit où l’on égrène les années, 1880, 1904, 1930, 1966, 2016, 2018. Faites danser le cornet, faites rouler les dés, au grès de vos envies.
Je me perdais dans le dédale des rues sans numéro.
Je passais devant le national museum, le Haweel market, le gulf mail.
Au Sakran, coffee shop, je demandais mon chemin.« Il est midi, l’heure où le soleil est au plus haut, ne voulez-vous pas entrer et manger un morceau, le restaurant est ouvert ». Je pensais à Soleillet, mort d’une insolation dans les rues d’Aden.
Besse ne m’attendait que vers les 15 heures.
Menu 1 proposé par le Sakran :
El mthloutha (potage de légumes)
Poitrine de poulet / frites
Salade de choux
Salade Mazza (mélange de Houmous, Fattousch, Taboua,), accompagnée d’une salade verte à l’ananas)
Fetta tamar (à base de dattes, bananes et feuilles de rose)

Menu 2
Laham madfoune, à base d’agneau
Mathrouda samath à base de poisson
Foie au pain Yéménite
Chèvre
Homard
Zoulikha dessert très sucré à base de noix, de nougat et de miel
Thé, café, sodas (bières et whisky dans l’arrière-cuisine, avec bakchich)
Tout en mangeant je relisais mes notes, le rapport district consulaire sur Antonin Besse :
Antonin Besse est français, né le 26 juin 1877 au 12 rue de la République à Carcassonne (Aude).
Le père (marié, sept enfants), était négociant. La famille déménage à Montpellier. Le père décède en 1884.

Antonin Besse, cadet de la famille, fait de rapides études avant d’effectuer son service militaire.
Depuis le 16 avril 1899 réside à Aden sur Aidrus Road, quartier du cratère.
Il a été embauché par Bardey, import-export, à Aden. Chez son employeur se spécialise dans la commercialisation du café. Son contrat chez Bardey s’achève en 1902 et il créé sa propre entreprise à Hodeida et à Aden.
Il réussit, fait de bonnes affaires dans des usines de savon, d’huile de coco, dans l’import-export, dans la corne de l’Afrique et le sud de l’Arabie.
Il est agent des firmes Shell, Persian Oil Compagny (BP), il s’occupe de livraison et commerce de kérosène, de pétrole. Il est président de la compagnie Aden Airways et du club de football local.
Bonnes mœurs, pas de contact particulier avec les autorités Britanniques, celles-ci se limitant aux transactions commerciales.
À noter, cependant, des sentiments pour les ouvriers et les grévistes en général, mais avec discernement. Ne fait pas parler de lui et n’énonce pas ses convictions politiques.
Vient de se rendre acquéreur des hôtels suivants :
- L’hôtel Crescent.
- L’hôtel du Croissant
- L’hôtel Marina
- L’hôtel de l’Europe
- Et L’hôtel de l’Univers, même en ruines, était là ; la photo sur la terrasse témoignait. Jules Suel était toujours en pyjama, Rimbaud avait une sale gueule, la factorerie près du minaret de la mosquée, faisait face au tribunal Britannique.
Posez vos valises, les employés vont s’occuper de vous, vous offrir un thé vert et des gourmandises orientales, des friandises à base de noix, amandes, nougats, calissons, bakhava, Ouzbek, Talkysh Keleve, sweet banner, kaliba, Makront et autres bazzman, toutes plus bonnes (et sucrées) les unes que les autres. Appelées aussi, par les coloniaux « saute-dentiers « (!). Tout cela avec le sourire, l’hospitalité des Orientaux.
Entrez dans l’hôtel Crescent de Steamer Point.
L’hôtel, magnifique avec ses trois étages, change de nom en 1966 pour devenir le Rock hôtel. Il est encaissé entre roc, sables, corniches, routes ne menant nulle part, avec un environnement de zone commerciale. Tout près, sur Maala Straicht, le port voit pourrir doucement les restes du « Prince of Wales », abandonné, sur le quai.
Le pier, port de Dhow, comporte une enclave abritant un cimetière.
On dit qu’y serait enterré Caïn.
Au loin les îles des esclaves chuchotent d’autres légendes venues de la nuit des temps.
La reine de Saba s’abreuve dans les immenses réservoirs d’eau (toujours visibles).
À cheikh Othman on maintient les fameux jardins. Les chèvres s’y baladent. La bourgade vit du commerce de la teinture des tissus, des draps.
Sortez de la ville en évitant la silent valley qui débouche sur des installations militaires, des chemins perdus dans la nuit.
J’avançais, j’avançais.
Un jeune Berbère m’accosta : « C’est toi le Franchie qui vient pour M. Besse ? Suis-moi, Il t’attend, je vais te mener auprès de lui ».
Pourquoi, à ce moment précis, me reviennent des images, l’image d’Armgart, venant d’Araoué, se rendant à l’hôpital du Harar afin d’y soigner les lépreux, l’image du père Angelo Pagano, vicaire apostolique, sortant de sa cure, pour rendre visite à ses ouailles.
Les pensées se télescopent, respirons un grand coup. Continuons.
Je marche dans les rues d’Aden guidé par le jeune Berbère.
T’es qui l’Frenchie ?
– Je suis le Franchie qui écribouille, lâchant l’encre de mes pensée.
Le jeune Berbère me regarde et sourit.
L’ancre de marine pâlira sur les cotons militaires, disparaîtra.
Tous les francophone d’Aden continueront d’authentifier leurs souvenirs. A la faculté de lettres de l’université d’Aden, on tue les lettrés, à tour de bras, bras armé par la guerre. Personne n’est à l’abri de la violence, dans les rues, les mosquées, les universités et bibliothèques, sur les marchés. La guerre.
Le néant.
Seuls les dérisoires cerfs-volants des enfants rescapés de la folie des hommes continuent de tournoyer dans l’azur.
« Nous ne sommes pas au monde » AR.
Nous contournons quelques rues, débouchons sur une place : poussière, chaleur, pollution, on n’y voit goutte. Au loin venait les échos des bazars.
Un taxi, une vieille Mustang qui avait connu des jours meilleurs, attendait le client, portes ouvertes. Le chauffeur hélait les gamins, il devait les connaître.
Les maisons à encorbellement, vérandas au-dessus d’arcades (dépôts de marchandises, sockage), silencieuses, semblaient désertées.
L’heure du khat, m’expliqua mon guide.
Soudain, mon cœur bondit : j’avais reconnu l’hôtel de l’Univers, le mythique hôtel.
Je prévenais le jeune guide « A few minutes, please ».
L’hôtel tenait debout, mais il était décrépi. La peinture de la façade s’écaillait, la porte à tambour, en lambeaux, tournait péniblement, grasseyait.
J’entrais. Y avait-il encore une chambre dans cet hôtel désert? J’en découvrais une, spartiate, le sol recouvert d’un épais tapis élimé, du linoléum sur les murs, un rideau jaune de crasse bouchant la fenêtre. Le ventilateur du plafond, ahanant, devait dater d’avant-guerre. Quelle guerre ?
De la même année le lit post-moderne, plastifié. Une coiffeuse Hollywood, du siècle dernier, délabrée, occupait un coin.
Je sortais de ce lieu de sortilège.
Le jeune Berbère m’attendait, en mastiquant, la joue gonflée. Le khât, en attendant le Franchie… Sur la place de maigres eucalyptus disputaient le vert de leur branches au bleu du ciel, un bleu presque irréel, mangeant tout, les autres couleurs, le soleil, la chaleur.
J’étais fatigué et mes vues se télescopaient.
N’était-ce pas Suel qui approchait, en pyjama rose, les bras ouverts, à ma rencontre ?
Puis le petit Berbère s’arrêta, me pointant une bâtisse au bord de la route, un peu en retrait. « C’est là » me dit-il en pointant un doigt vers l’habitation puis en m’ouvrant la main. Je lui donnais quelques roubles et il disparut.
En m’approchant je découvrais une grande maison d’angle, en pierre grise.
J’avalais la poussière. Les bâtiments cachaient le soleil. J’étais seul sur la grande place.
Sur un mur une réclame « : Aden porte savon ». Comme porte avion, porte jarretelles ?
Je touchais à la bâtisse. La maison consistait en un long bâtiment, sorte de hangar, avec trois portes fermées, dont une sécurisée par des barreaux et un cadenas.
En bas les stocks, les magasin, en haut on devinait des appartements.
Je n’eus pas le temps de chercher l’huis que, soudainement, au premier étage, un volet claqua laissant voir une tête de jeune Yéménite, tout sourire.
« Vous êtes le Franchie ? Je descends ».
Avec la légèreté d’un oiseau elle se trouva rapidement devant moi, jeune femme souriante. Elle inclina le buste, porta ses mains jointes devant son front, ses lèvres, son cœur.
« Zadira », dit-elle simplement. Je vous conduis.
Antonin Besse.
Il a les cheveux blancs, taillés en brosse, de gros sourcils noirs, et des lèvres minces. Un peu de corpulence, un sourire carnassier, des yeux jaunes, très mobiles.
Il me reçoit dans sa chambre, étendu sur le lit. Il m’invite à m’asseoir sur un fauteuil crapaud. Il a une figure colorée et une petite voix de miel.
« Je suis descendu au Crescent », ne voulant pas lui rappeler son invitation à séjourner chez lui.
« Ah ! le Crescent ! Vous savez qu’il m’appartient ? Vous y serez bien. Je vais donner des ordres pour toutes commodités que vous pourriez désirer ».
Un petit chez soi vaut mieux qu’un grand chez les autres. Tant mieux, je serai plus tranquille. La conversation a du mal à prendre. Le roi du pétrole, le propriétaire en chef d’Aden parle, se fait mousser, s’enorgueillit de ses succès, de l’argent qu’il a gagné ici, et puis les mondanités, les contacts créés, les relations d’affaires, très importantes.

Le pouvoir et l’argent. Je savais déjà qu’il payait ses employés français à coup de pierre, mais qu’il donnait de bons gages aux salariés Indiens, Juifs. Sa petite voix de châtré résonnait à mes oreilles comme un bourdonnement d’abeilles. « Vous savez, les Adénis sont un ramassis de brigands, je le sais, depuis le temps que je fréquente cette engeance-là. »
Je m’étais renseigné sur le roi du pétrole : on le disait charmeur, plein d’énergie, une belle personnalité. Mais on le disait aussi plein de petitesses, de ladreries, cassant, cruel. Pas très sympathique.
Je savais aussi qu’il n’avait pas fait d’études, qu’il avait échoué au bac, et qu’il était athée.
Ancien employé de Bardey il avait monté sa propre boîte grâce aux capitaux d’un banquier Indien.
Il avait adopté la devise de Saint Exupéry « Plus est en vous ».
Enfin, il avait fait des affaires avec Monfreid (tous les deux n’aimaient pas les Européens, d’où l’affinité).
Fatigué des atermoiements de ses nombreux employés, leurs départs, leur manque d’implication, il recrutait son personnel par l’intermédiaire de son bureau à Londres.
Voilà le personnage avec qui je devais fréquenter, qui allait m’aider, me proposer…quoi ?
Je l’ignorais.
Le ronronnement d’abeilles reprenait, avec sa voix de crécelle « …comme je vous le disais, une bande de brigands, mais ne renoncez pas…. Vous m’écoutez ? ».
Il parlait d’une voix lente, allongée, se parlait à lui-même. Les yeux jaunes, mobiles, se dérobaient, lisant dans mes pensées, anticipant mes réactions.
Je m’installais dans un relation trouble avec une personne qui n’avait à la bouche que le dicton : « les affaires sont les affaires ».
Les abeilles reprenaient « mais il se fait tard, monsieur, je vous invite à vous joindre à nous ; nous soupons à deux pas d’ici. »
Par l’Abbey Road nous arrivâmes au mess des officiers, vaste demeure, réservée à l’élite, point de jonction entre l’armée et les civils, point alimenté par la présence des occupants, les Britanniques et les autres Européens, Français, Italiens, les habitants de la côte, au-delà de la corne : Yéménites, Somalis, Indiens, Juifs.
Humphrey Berk’ley, le gouverneur, double, en rouerie, de Besse, avait la main sur la population, grata, non grata. Tout comme Besse il arborait le nœud papillon dans les réunions et la rosette, bien en vue, assurait la présidence de la British East India Company pour Aden. Il contrôlait tout le pays, du canal de Suez au cap Gardafui.
On me présenta à Edward Ellice et William Gladstone, qui œuvraient pour le Daily Mail, de Londres, Thibault Lefefvre, du troisième bureau, chargé de la lutte contre la piraterie et son second, Siroco, un Yéménite de Saana.
Ils revenaient de Zanzibar, trompant leur ennui dans le gin fizz, Je les imaginais accoudés au bar du Murayry’s de Stone Town, et faisant la tournée des bordels de l’île. C’était Ramadan, les pirates leur accordaient une pause.
Ils me parlèrent de Djibouti, évoquèrent la Flèche rouge, le Cintra, le Képi blanc. On me présenta également le banquier Bertrand Mandico, qui avait inventé un procédé pour éliminer l’odeur de l’urine des dromadaires sur les billets de banque, odeur que les Britanniques ne supportaient pas (!).
Les femmes, en robes de soirée, offraient leurs seins et leurs frustrations aux invités mâles, dans un sourire béat… Ces femmes, d’anciennes prostituées reconverties, délaissées du contingent, femmes, maîtresses d’officiers, allaient, de Djibouti à Aden, replâtrer des virginités en miettes, parures aléatoires des soirées annoncées.
Au-delà des mers et de la mère- patrie on se bricolait une morale.
On se mit à table dans un salon privé, les lustres de cristal éclairant les agapes.
Je me trouvais placé près de hauts fonctionnaires, Jacques Roquette, Georges Chantelot, des gueules d’agent secret, de baroudeur cuits et recuits.
En mangeant ma soupe de poissons je les entendais évoquer des lieux, des personnages, Hormuzd Rascam, Tewodros, les soirées à l’East India Club.
Johnny Walker semblait être l’un de leur vieux copain et les bouteilles de whisky filaient plus vite que les boutres de Monfreid.
« Ah ! Vous êtes le français Djiboutien arrivé dernièrement à Aden ? Antonin m’a prévenu de votre arrivée. Vous êtes son correspondant Londonien ? ».
Je ne démentais pas et acquiessais en hochant la tête. Pas la peine d’amorcer la conversation, il était bavard comme une pie. Quand il vint à me parler du « In et Out » du Saint James de Londres, d’Alain Villiers, banquier et éditeur, je compris qu’il me prenait pour un autre. Je l’écoutais en souriant, hochant, de temps en temps, la tête, comme le font les chiens en peluche à l’arrière des automobiles.
« Alors, que pensez-vous de notre petit club. Tout le monde se connaît. On fait la fête, on fait des affaires et…. ».
Un énorme bruit retentit, suivi de cris.
Dans les cuisines on avait remisé une cage contenant un léopard, capturé dans les montagnes l’après-midi. L’un des convives, éméché, le voyant, avait ouvert la cage. Le fauve, entrevoyant la liberté, avait bondi, de la cantine aux tables de la salle. Stupeur !
La bête fut rapidement maîtrisée.
Résultats : deux femmes évanouies, revenues à elles par de viriles paire de gifles, une table dévastée, la nappe entraînant vaisselle, bouteilles.
« Ali, Ali, vite » glapissait le maître des cérémonies. Tout rentra dans l’ordre et Humphrey Berkeley s’enquit du responsable et le fit venir à sa table.
Celui-ci, la queue entre les jambes, moitié hilare, moitié penaud, pas tout à fait dégrisé, plaida sa cause en disant qu’il voulait juste caresser le fauve, le prenant pour un chat.
Le président voulut exclure du cercle le fautif mais un gros homme chauve, en habit, s’approcha, et lui murmura quelques mots à l’oreille. Je tendis la mienne et récoltais quelques mots (c’est le neveu de…..oui, la Shell company….).
À quelques tables plus loin j’apercevais Antonin Besse en grande discussion avec des intimes- relations d’affaires ? – levant ses bras, ses yeux plus jaunes et plus mobiles que jamais. Absorbé par la discussion il n’avait pas remarqué l’incident du léopard.
Une légère touche de fièvre me reprenait – H. Pelletier ne me lâchait pas – et je quittai la salle, la soirée, ces inconnus et, m’en allant, je saluais Besse. Je prétextais la fatigue du voyage « Et vous remercierais nos hôtes, la soirée était parfaite ».
Revenant à l’hôtel Crescent, par la nuit noire, j’étais guidé par les loupiotes des rues et l’éclairage violent des enseignes des hôtels avoisinants.
« Bonsoir, vous êtes l’invité de M. Besse, le propriétaire, qui vous souhaite la bienvenue. Nous vous offrons tous les services attendus. Bonne nuit, Monsieur ».
Entrant dans ma chambre je m’attendais à trouver une fille dans mon lit et le champagne au frais. Il n’en était rien, et tant mieux. Je n’aurais pas assuré pour la bagatelle et le champagne de l’hôtel, un mousseux que l’on mélangeait de coca, portait, sur l’étiquette de la bouteille « champagne made in Spain ».
Aden, des rencontres troubles, troublées, troublantes, instructives.
La lumière était crue, la nuit, noire.
On change de continent comme on change de braquet.
Qu’étais-je venu faire ici ? Après les deux premiers chapitres, Harar, Djibouti, Rimbaud et Monfreid, j’aurais dû attraper l’avion pour Alexandrie, donner mon congé, puis prendre le bateau pour la France et remercier Églantin.
Ma corne d’Afrique avait des allures de cul-de-sac.
Je m’endormais dans des draps propres, au son des mélopées, la tête sous l’oreiller.
Évidemment le brin de fièvre restant m’encouragea au rêve : je prenais la parole devant mille militaires en treillis, mille pirates armés jusqu’aux dents, hostiles à mes propos et qui, bientôt, lâcheraient sur moi tous les léopards et autres bêtes sauvages de la planète.
Ils fêteraient alors mon trépas, levant leur verre devant mon corps déchiqueté et salueraient en rigolant : « this is good for you ! ».
Le lendemain matin je m’éveillais avec le visage de Zadira tout près de moi.
J’eus un sursaut. J’étais nu comme un ver.
« Alors, on ne frappe pas en entrant dans la chambre d’un monsieur? »,
« Non, non, on ne frappe pas », son sourire éclatant éclairait mon réveil.
Zadira avait une voix de miel. Son patron une voix de crécelle.
« Alors le p’tit Frenchie il a bien dormi ? Je vous ai fait du café bien fort, avec du lait d’ânesse, et des tartines.
Dans la cuisine attenante, mosaïque et formica, étaient accroché des photos de moustachus à lunettes, une affiche de Rocky, Sylvester Stallone, Rambo, frère jumeau de Rimbaud. Celui-ci trônait dans un cadre en pierre, sur la table, entre le sel et le poivre. En dessous de la photo on lisait Éditions de S. Bernard et A. Guyaux.
(Suzanne Bernard LA spécialiste de Rimbaud, Guyaux, du collège de France)
« Ça va, une bonne nuit ? Les sauterelles ne vous ont pas embêtées ?
Monsieur Besse vous attend, au club des gardes.
Vous prenez à gauche, la rue Ali Abd-Latif. Tout au bout l’hippodrome, là où l’on fait courir les autruches me dit-elle avec un nouveau sourire, goguenard, en voyant ma tête.
« Je vous laisse. On laisse tout ouvert. Je suis toujours là ». Un signe de la main et elle disparaît. Une apparition.
Dans la rue, un homme, sur une chaise, torse nu, se faisait couper les cheveux.
Au bout de la rue l’hippodrome, des autruches en trolley avec, sur l’une d’elle…Antonin Besse, en grande discussion avec un employé.
Je l’avais vu hier, assis dans la pénombre d’un appartement.
Je le voyais, ce matin, en pleine lumière, son corps trapu, corpulent attaché au trolley comme à une bouée de sauvetage. Un crapaud sur une boîte d’allumettes.
Il parlait, le bourdonnement d’abeilles était continuel.
« Ah ! Vous voilà ! Vous êtes bien reposé et prêt à m’écouter. Je vous présente
M. Clarvreuil, Stéphane Clarvreuil, de chez Sotheby’s, Londres. Il est chargé de mes intérêts dans la vente des collections de Pierre Berger. Je ne peux m’y rendre mais, avec mes recommandations, il va emporter le lot. Une sacrée plus-value, je vous le dit. Et même….. « Il parlait, marchait, décidait tout en marchand, des affaires, de ses affaires, des affaires du monde.
M. de Sotheby’s et moi-même suivions derrière.
Comme des petits chiens ?
Employés. À quoi ?
Sous une véranda, près des boxes une plaque en bronze :
« Élevage d’autruches Le Paradis
Courses de trotteurs, lévriers, autruches
Souvenir de François Mesnard de Cornichard
Les anciens du Parc aux zèbres 1930 »
Besse congédia M. Sotheby’s et attaqua, devant les orangeades servies :
« Je vous ai fait venir, de France, de Djibouti, et nous voici, tous les deux, chez moi, à Aden, au » Paradis « pour parler affaires. Comment trouvez-vous la ville ? »
Il avait un sourire satisfait. Il s’étalait, débonnaire, son corps débordant du fauteuil d’osier.
Je le laissais venir. D’ailleurs, il parlait pour deux. Sa voix de châtré résonnait dans l’air atone. Tout près on s’occupait des autruches. Des stocks de plumes attendaient dans un coin. « On les fait sécher, elles passent dans une soufflerie puis, après quelques jours, on les enduits d’un produit pour éviter la casse et on les envoie, par bateau, en Europe, à Paris, l’Alcazar, le Mirliton, à Paris, des bons clients ».
Il s’arrêta, finit son verre, n’en dit pas plus. Ses yeux étaient jaune dorés et me scrutaient.
Je finissais mentalement sa phrase : un peu d’argent de poche quand j’ai besoin de graisser la patte d’un fonctionnaire, d’un politique, et rémunérer mes gardes, un peu espions, un peu indics qui fricotent dans les milieux mondains, qui connaissent les potins, les projets des uns, des autres.
Antonin Besse
Import-export
Aden
Yémen
Une carte de visite qui ouvrait bien des portes.
Devant mon mutisme il se tut, leva la tête, regardant les colibris Yousti passant dans le ciel.
« Je voudrais que vous écriviez ma biographie », dit-il, tout à trac.
Des cavalières passaient près de la véranda. Besse les salua de la main « on se voit ce soir au club ? » « Ce soir, oui ».
Il les suivit du regard. Ces femmes de colonels, d’administrateurs, d’actionnaires gavés, avaient leurs habitudes.
Sans doute, dans leurs courriers pour la métropole, n’omettaient-elles pas de signaler l’hippodrome, les si originales courses d’autruches, les soirées. La belle vie.
Les cartes de membres locaux du Lyon’s club, Rotary, Kiwanis avoisinaient-elles celles des clubs Colbert, Jockey Club ? On était entre soi et l’on fêtait les réussites – toutes les réussites – au bar du Ould Mohur swimming pool.
Piscine, tennis, golf, à la demande, mais il n’y avait ni jeu de polo ni jeu de cricket, au grand dam des Britanniques qui, revenant des Indes, s’ennuyaient ferme sur ce roc » sans une goutte d’eau, sans un brin d’herbe ». Certains, faisant jouer leurs relations, faisaient avancer la date de leur départ ; les autres, moins nombreux, sans relations, buvaient, forniquaient et finissaient en épaves.
J’étais arrivé et ma vie se cristallisait sur un verre d’orange, des autruches, et à un homme d’affaires qui me demandait d’écrire pour lui.
« Je voudrais que vous écriviez ma biographie.
Je sais tout de vous, de votre parcours, les bibliothèques, Carnegie, Alexandrie, le garage Marill, vos virées avec Théilard de Chardin, et puis vos commentaires sur certaines photos, comme la neuvième, prise sur la terrasse, à Aden, vos liens avec les libraires près de Saint Bernard,, vos correspondances avec Georges-Daniel, Armgart, vos recherches sur Rimbaud –un puits sans fond – et j’étais au cap Gardafui quand vous y étiez, et sur l’ile de Socotra avec le cheik Issa Ben Séoud.
Je déduis de tout cela que vous êtes un drôle de zèbre, un original qui manie le stylo intègre jusqu’à la naïveté, intègre jusqu’à la bêtise, tout cela me mène, logiquement, à penser que vous êtes un incorruptible, droit comme un i et que vous ne me décevrez pas. (Il eût un mince sourire baffant son visage grêlé de petite vérole, comme un sourire de gros crapaud pustuleux). Un crapaud millionnaire.
Écrivez ma biographie.
Dix mille dollars.
Je paie cash, en petites coupures ou sur un compte numéroté à Londres ou Genève.
Mais venez, je vais vous donner les détails de ma proposition.
Il me donna le bras et nous devisâmes, en cheminant.
Je me méfie des gens inconnus qui vous donnent le bras.
Pour dix mille dollars combien de bras pouvait-on supporter ?
Au loin, dans la poussière d’or du couchant, je voyais Rimbaud, Jules Suel, Théilard, In Baba, fille d’Armgart, Thaurin-Cahagne levant les bras, me faisant de grands signes depuis la rive opposée, me criant : « mais que faites-vous, vous vous fourvoyez ».
Dans les jardins, forcément luxuriant, les palmiers se balançaient mollement.
« Voyez-vous, une biographie, c’est l’histoire d’une vie particulière, l’interprétation d’un parcours et…. »
« On ne comprend rien à votre histoire. L’auteur est-il riche, sans le sou, pensionné. A-t-il hérité, braqué une banque. Enfin, qui est-il ? Aucun renseignement. Le comité de lecteurs se joint au comité de lecture pour émettre les plus extrêmes réserves. »
(Lettre à la société des gens de Lettres 14 avril 1930). Mes comptenteurs se montraient retors.
Il poursuivait, toujours accroché à mon bras, dessinant sur le sable avec sa badine.
« …un parcours, une volonté d’intérêt, d’oubli, une mémoire.
Je pense aux inscriptions sur les stèles d’Égypte. Suis-je un exemple, un modèle, un monstre pétri de vanités qui fait lui-même l’éloge de ses qualités, de ses vertus ? Un dérangé, un fou ? Aden est un paradis retrouvé. En suis-je le phénix ?
J’ai réussi, continuait Besse, je possède tout, bêtes et gens, des coffres pleins à craquer, des sociétés, des comptes, Afrique, Asie ».
Il monologuait, me serrant le bras plus fort.
Il reprenait, monologuait, comme si j’étais absent :
« Je vais être nommé président du conseil d’administration, puis, bientôt, directeur général de la Faber § Geseischt Industy. Je vais inonder le monde de pétrole synthétique. »
Puis, soudain, il tourna court.
« J’ai rendez-vous, prochainement, avec le sultan de Lahej. Quel que soit votre décision – je vous donne une semaine – voyez mes hommes d’affaires, au siège, W.L. Clark, Grison D. Bekrens, des juristes Américains. Ils s’occupent des contrats.
Pour la petite cuisine voyez Miss Fox, Miss Scott, fidèles secrétaires qui ont déjà le synopsis, le plan général de ce que je souhaite. Ces secrétaires ont toute ma confiance.
Miss Scott est une littéraire doublée d’une érudite, je pense que c’est avec elle que vous allez travailler.
Passez par le siège, Fox vous remettra une enveloppe.
Passez par le siège, l’assistant de Clark vous remettra les clés d’un 4 X 4 Toyota neuf.
Oui, bien sûr que je connais le concessionnaire, Marill à Djibouti. C’est chez lui que vous souhaitez continuer votre enquête, je crois, pour votre livre….mais penser à ma proposition, aussi ».
Les yeux jaunes me scrutaient, essayer de me deviner.
Je ne répondais pas
Il reprit.
« Nous fêterons votre décision, quel qu’elle soit, et votre départ, au cercle, avec quelques amis.
Aussi, au revoir. Je suis joignable, n’importe où, n’importe quand ».
Ses yeux avaient pris la couleurs des rives mordorées de la mer Rouge.
« Bon vent ! Je pars pour rencontrer le gouvernement Indien, une commande importante de travaux publics, grues, tracteurs ».
Il me fixa comme si, de nouveau, il voulait me sonder (étais-je pour lui, vraiment, une bonne affaire ?).
Le crapaud millionnaire tourna les talons et me laissa, mille impressions en tête.
La soirée avançait et, la chaleur tombait.
L’air était doux et parfumé.
Les deux boys, Ali et Abdo s’approchèrent, me proposant des vêtements de marque, cadeaux de Besse.
Parmi ceux-ci, un smoking, un smoking pour les soirées « in » d’Aden.
Il m’achetait.
Je souriais en dépliant ce smoking saumon de la meilleure coupe.
Lagarde, à Obock, puis à Djibouti, l’enfilerait pour les réceptions de Chapon-Baissac.
Monfreid, à Paris, dépareillait son smoking saumon en enfilant ses espadrilles, faisait étalage de sa réussite dans les soirées mondaines (il postulera, bientôt, pour l’Agagadémie Française).
Rimbaud, au Harar, ne possédait pas de smoking mais un costume de bagnard, blanc, oriflamme de l’humanité, témoin de l’inanité des choses.
Je refaisais le paquet, le remisais à l’hôtel puis me dirigeais vers les palmiers du siège, ma suit-case sous le bras.
L’entrevue avec les deux Miss, fidèles assistantes, se passa bien.
Miss Fox me remit, sans un mot, une enveloppe tiré d’un coffre masqué par une plante exubérante, me fit signer un reçu et me demanda de n’ouvrir le paquet qu’une fois rentré à l’hôtel. Le reçu mentionnait simplement un nom et une date.
Miss Fox avait une tête de Sainte Catherine qui aurait eu l’expérience des hommes, une sorte de « ne me touche pas mais touche moi-plus ». Elle avait travaillé pour la Royal Air Force, portait des vêtements masculins et le glose de son maquillage faisait ressortir son hâle attrapé en Orient. Assez jolie, assez distante. Une professionnelle.
Contrairement à sa collègue, Miss Scott invita à m’asseoir. Les bureaux des deux miss étaient climatisés, séparés par une paroi de verre translucide, de grands bureaux. L’ordre y régnait, dans les têtes, dans les dossiers.
Par la fenêtre des reflets d’argent vous rappelaient la proximité de la mer, les vagues qui s’enroulaient.
Dans quelques heures, les passants suffoqueraient sous la chaleur oppressante.
Miss Scott (dans mon esprit « Biscotte »), était de Douvres, avait habité longtemps
L’Écosse. Elle avait fait éditer, à Edimbourg, chez Jullian and Co, un ouvrage sur
Robert Burns.
Elle avait une voix rauque, traînante, très sensuelle, avec des mots choisis pour un énoncé qu’elle voulait technique mais qui, sous des dessous littéraires, se dérobait, lui donnant un autre sens.
Elle m’interrogea sur mes parcours, sans peser, évoquant la gastronomie et les vins français, en guise de hors d’œuvres.
Connaissez-vous la personne qui a postulé pour le poste d’ingénieur-conducteur aux Messageries Maritimes et qui, paraît-il… ?
« Ah ! Oui, le fameux homonyme du poète ! J’ai déjà pris un verre avec le récipiendaire. Il est amusant d’avoir un double, deux Rimbaud pour le prix d’un, l’un échoué chez Bardey, future idole, l’autre courant la mer, l’océan, complètement inconnu. »
J’avais jeté l’hameçon. J’attendais qu’elle dévide la pelote, Rimbaud, Bardey, Monfreid, Marill, jusqu’à moi. Allez ! Allez !
Elle ne dévida rien, cherchant des papiers dans une chemise.
D’ailleurs, ajoutais-je, en me penchant vers elle, qui vous dit qu’il s’appelle Rimbaud ?
Elle leva lentement les yeux vers moi, me scrutant, pâle soudainement.
Elle ouvrit la bouche, m’interrogeant des yeux, intensément.
Le monde allait basculer. Un vertige nous prit, tous les deux. Si je n’étais pas celui qu’elle croyait, qui étais-je ? Que lui avait raconté Besse ? La fiction et la réalité, dans un tourbillon, se rejoignaient, s’entrechoquaient.
Miss Scott n’était que bruissement, interloquée.
J’étais l’idiot, à mon clavier, déroulant une histoire.
Quelques secondes, suspendues dans l’éternité, à nous dévisager, immobiles.
Puis le charme se rompit, les choses reprirent des couleurs, la vie redevint coutumière, prosaïque.
Alors, en secrétaire dévouée :
« Monsieur Besse me charge de vous communiquer ses intentions, son rêve de voir conduire ce projet de livre ».
Un crapaud millionnaire rêveur.
Elle m’expliqua, me précisa, me donna des thèmes, les choses qu’il fallait développer, celles qu’il ne souhaitait pas être mentionnées, le nombre de pages et le temps prévu pour l’écriture, la lecture, les rencontres in fine avec les éditeurs, enfin, tout un catalogue de précisions. « Tu es nègre », écrivait l’Ardennais. On y était et cela me fit rire.
Elle ressemblait à Marlène Jobert, primesautière, faisant sauter ses taches de rousseur mais, je ne sais pourquoi, je pensais qu’elle devait être plus féroce, plus canaille qu’elle n’en avait l’air. Marlène Jobert mâtinée de Mata-Hari. Une belle composition.
Une littéraire doublée d’une érudite avait dit Besse.
Je soupesais mentalement l’enveloppe.
Mes détracteurs la soupèseraient bien mieux que moi. Ils éructeraient que je n’avais qu’à prendre l’argent, et basta.
Il était midi.
« Prends l’oseille et tire-toi ».
On allait jouer ça aux dés.
« Et, bien sûr, vous êtes encore libre de refuser l’offre. Vous gardez votre libre-arbitre, votre liberté, vous comprenez ».
Elle avait dit ça comme elle aurait dit : « allez dans la paix du Christ », en me tenant du coin de l’œil.
Serait-il iconoclaste de répondre favorablement, d’accepter l’offre : écrire la biographie d’un margoulin, fossoyeur de nos rêves les plus purs, se méprendre sur le sens de la vie pour une poignée de sequins reçus, comme Judas livrant son maître puis jetant l’argent pour aller se faire pendre ?
Mais je soupesais mentalement l’enveloppe. Je n’étais pas plus malin qu’un autre.
Accepter, empocher l’argent…et le donner aux déshérités.
« Ainsi, je jouerai un bon tour à la folie » AR.
Je remerciais Biscotte, promettant de revenir bientôt pour la réponse.
Dehors, l’odeur puissante d’un chèvrefeuille géant – un arbre à parfums – sauta dans mon enfance. Les couleurs, les sons, se mélangèrent.
J’étais à Aden, jeune, plein de vigueur, avec un destin à étreindre.
Mais je ne me rappelais pas mon nom.
Sur le chemin de l’hôtel je revoyais mon plan :
Conserver l’argent dans le coffre de l’hôtel.
Dire OUI à Biscotte
Trouver un endroit tranquille pour écrire.
Mettre mes pas dans ceux de Tian, Riès, Bardey, Marill, Chardin.
Découvrir Aden, rencontrer Nizan.
Biscotte et Besse m’approcheraient.
C’était un bon plan. Ça tenait la route. J’étais serein.
J’avais accès au coffre de l’hôtel et je me débarrassais de l’enveloppe.
Dans l’enveloppe : cinq mille dollars, en petites coupures, comme promis. Le reste à la livraison. Pas de mot d’accompagnement.
Je pris une douche et me rendis, sifflotant, à « L’herbe folle », un établissement Français qui venait d’ouvrir près du port. J’allais réveiller les couleurs et les sons.
Demain j’irai donner ma réponse à Biscotte, décider de mon départ, et prendre livraison du Toyota.
Le lendemain matin je me présentais, de bonne heure-, au siège de « Antonin Besse’s firm, all over the world. »
Les deux secrétaires et les deux juristes étaient là.
En scrutant mon visage, Biscotte devina ma réponse. Les deux Amerloques me dévisageaient en silence, attentifs.
« Well, about M. Besse’ s proposition the answer is… (les deux juristes se regardèrent), YES.
J’en suis contente me dit Biscotte, les yeux dans le vague. Miss Fox ne bronchait pas, le nez dans ses papiers. (Elle ne me demanda pas des nouvelles de l’enveloppe.)
Je vais prévenir M. Besse. Pour le texte à venir vous avez toutes les instructions. Cela vous semble clair ?
Il n’y avait qu’à suivre le fil rouge, rouge comme la mer rouge.
Un thé, ou autre chose ?
Onze heures trente, l’heure de l’apéro.
Les Yankes reprenaient leur travail, me jetant, de temps à autre, un regard en biais… Du tiroir du bureau de l’un deux dépassait la crosse d’un révolver.
Vous êtes aimable. Un whisky, ou plutôt, un bourbon.
J’avais l’impression d’écrire le scénario d’un mauvais polar, un succédané d’un livre de James Hadley Chase.
En une seconde le bourbon, un Brooklin’s angel se trouva dans mes pognes.
Je vous accompagne, pour fêter ça ! Me biscotta-t-elle.
Nos amis Américains et ma collègue ne boivent pas.
Je sus, plus tard, que les deux Amerloques étaient en plein Ramadan (ils avaient pourtant de bonnes gueules de cow-boy bien blanc) et que Miss Cox était affiliée à la secte des Mormons, ou quelque chose d’approchant.
L’ange de Brooklin et les cacahuètes avalés je pris congé, saluant.
Biscotte m’accompagna. La porte ouverte du bureau donnait sur l’antichambre d’un four. 40 ° à l’ombre.
L’ombre des palétuviers offrait un sas de décompression, pour la chaleur, pour les dernières confidences que je devinais.
Asseyons-nous un instant, si vous voulez bien, sous cet auvent abrité.
J’ai à vous parler.
Elle parlait, j’écoutais.
Voilà, vous n’êtes pas le premier à qui M. Besse fait cette proposition de produire sa propre histoire, mais….Elle s’arrêta, ôtant quelques feuilles fanées du palétuvier, goutant le soleil et la beauté du dehors.
De profil elle s’alignait sur un visage de madone, avec quelque chose de vicelard dans le regard.
Une miss, oui, mais aussi, l’image d’une bonne sœur toute nue avec une cornette, offrant sa toison rasée, de la taille d’un ticket de métro.
Mon imagination battait la campagne, galopait au-delà. La chaleur, sans doute.
Mais, reprit-elle, ou bien le postulant était trop gourmand (dix mille dollars !) ou bien c’est M. Besse qui ne sentait pas, après réflexion, le candidat. Il a le jugement sur, vous savez.
Je me rappelais le regard pointu du crapaud millionnaire.
Je pense qu’il vous a choisi pour votre originalité et puis, surtout, il vous a jugé. Vous pensez bien qu’après toutes ces années, ces expériences de meneur d’hommes, confronté à certaines réalités, il sait tout de suite à qui il a affaire, à qui il peut faire confiance.
J’aimais bien les expressions « confronté à certaines réalités », « faire confiance ».
Instructives et douces à mon oreille.
Quels sont vos plans ? Où et quand allez-vous débuter le manuscrit ?
Il y a l’argent, le Toyota. Vous ne passerez que par moi pour la suite. Pour tout renseignement voici ma carte. J’ajoute celle de James Hallifax et de son assistant, nos correspondants pour le Moyen-Orient, seulement en cas d’urgence ou si vous ne pouvez me joindre. Oubliez Miss Cox et les deux Américains, vous ne les avez jamais vus.
Je lui indiquais mon projet de traverser le détroit, de me rendre à Djibouti, chez Marill, les rencontrer. Je ne mentionnais pas le nom d’Églantin.
Bien, je vais faire le nécessaire, votre passage en mer, les papiers, la douane pour le 4 x 4.
Vous savez où me trouver.
Vous n’avez plus qu’à déverser des litres d’encre pour la plus grande gloire de M. Besse’ firm, all over the world.
Je vous souhaite bon voyage.
Elle quitta le auvent, sa fine silhouette s’évaporant dans le soleil.
Je reçu un pneu d’Églantin., de Djibouti.
« On t’attend là-bas ».
Toujours le téléphone Arabe.
Tout le monde se connaît.
Je me regardais dans un miroir.
J’étais double-face d’écriture.
L’une pour le voyage littéraire dans la Corne de l’Afrique, un désir contenu, l’autre pour la biographie d’Antonin Besse, une commande.
Vous écrivez ? À qui ?
Le trajet pour Djibouti devait se faire à partir du port de Mokha, en ferry.

De ferry point mais un pétrolier, de la Royal Dutch Compagnie, acceptait de me prendre comme passager, moi, mon 4 x 4 neuf rutilant, mon enveloppe et le smoking saumon.
Biscotte avait télégraphié à Marill. Ils m’attendaient et s’occuperaient de l’entretien du 4 x4. Un Toyota Hilux, un pickup, un véhicule utilitaire, un monstre devant lequel je m’extasiai. J’avais les clés, le mode d’emploi et le plein était fait. Biscotte avait mis un mot, les papiers et deux cartes de la région, l’une des côtes de la mer rouge, l’autre de la ville de Djibouti.
Un fax des Marill m’annonçait qu’ils étaient contents de m’accueillir. Dans les papiers de la boîte à gants il était notifié : 4 x4 Toyota Système de démarrage en côte, contrôle de la motricité en descente, blocage des différentiels arrière, prècolision, boîte manuelle six vitesses, 150 chevaux, Cabine légende loun Moteur diesel 2.4 l d 40. Sièges en peau de zébi lustré. « Le refuge de l’Aventurier », indestructible depuis 1930.
Mais il y avait aussi un mot :
« Je vous annonce une nouvelle. Vous ne serez pas seul à Djibouti.
Votre cousin, Églantin Basquiast, ce bon vieux Eg’, est arrivé, sans crier gare, chez nous, venant de New York ».
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons tous les deux.
La communication entre vous, Antonin Besse, Églantin, et nous, marche très bien !
À bientôt !
Marill Community
Djibouti »
La communication marche très bien……….
Qui faisait quoi ?
Quelle année ?
Nous étions bien en Afrique…
À l’heure dite le pétrolier pétrola, accompagné de boutres, de sambouks, avec quelques pirates allant à la pêche aux imprudents.
Le pétrolier transportait du pétrole, quelques voitures et beaucoup de chameaux et de moutons. D’une rive à l’autre.
La traversée dura douze heures, le temps d’admirer le paysage. Nous longeâmes l’archipel Sonabi, mais aucune trace de Monfreid. On avait quitté Aden, ce grand volcan lunaire dont un pan a sauté (brochure office du tourisme, en Anglais).
Je n’étais pas aller saluer, avant mon départ, les juristes Américains, Clark et Bekrens, les homme de confiance de Besse. Bon vent !
Sur le pétrolier un Britannique engagea la conversation « Mais qu’est-ce qu’un Français vient foutre ici ? Et vous n’avez pas d’armes sur vous ? Vous savez que la mer et les Côtes ne sont pas surs ? William Gladstone, c’était le nom de cet Anglais bon teint et armé, évoqua des colons français des Messageries maritimes. Vous avez du connaître un certain Jean-Philippe Lafouine, auteur d’un livre incendiaire, un brûlot contre nous, contre la colonie Britannique. Il l’a fait éditer – à Zanzibar – mais Anastasie, la censure, veille.
Nous avons mis ce joli monsieur en cabane, à Arta, où il purge……..
Je n’écoutais plus. J’admirais les poissons-volants, les dauphins qui jouaient avec les vagues.
On vint contrôler nos passeports.
Le Britannique reprit : À Djibouti, allez, de ma part, à l’East Indian Club. Mon nom arabe est Ali Abd Ul Latif.
Les amis de Besse sont nos amis. Comment avait-il su ?
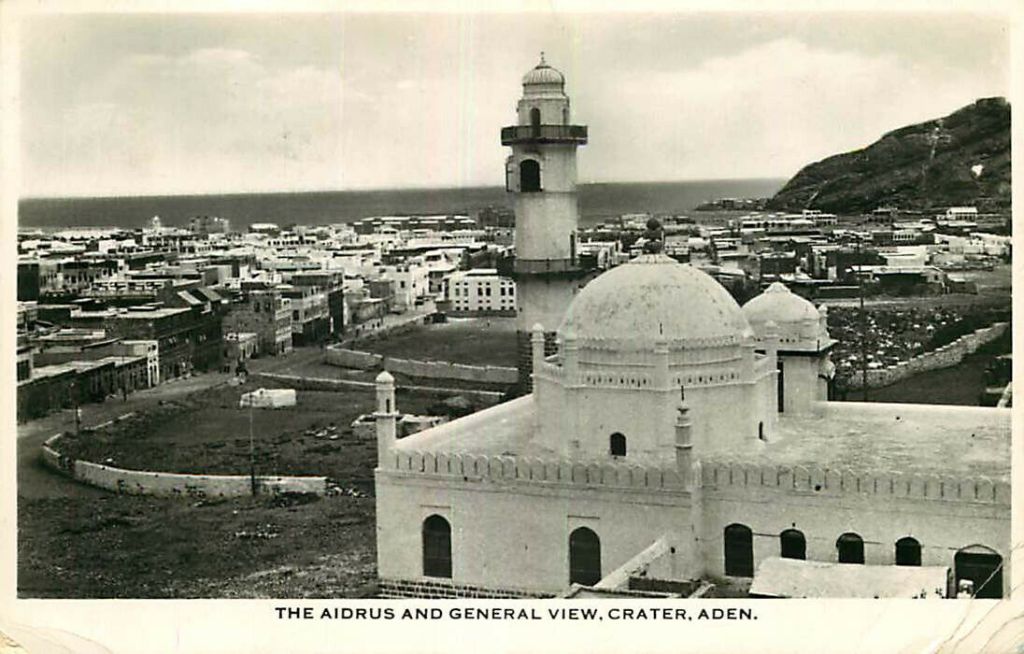
Le juge de la prose de Lafouine me parla, parla… De Jean-Paul Miguet, de la capitainerie du port, un dur, couvert d’honneurs durant la dernière guerre, et atteint de vérole, maladie des baroudeurs.
Il me parla aussi de Victor Ségalen, qu’il avait bien connu « un écrivain mélancolique ». Je me gardais d’évoquer les noms de Georges-Daniel de Monfreid ou de Gauguin.
Encore moins ceux d’Églantin, de Marill.
Nous arrivions au port sans attaques de pirates.
William Gladstone me remit sa carte (j’ai entendu…. si vous allez à l’Est Indien club, je suis membre, j’y ai mes habitudes). Il y a un bar, un billard, c’est très confortable et l’on est entre nous. Il se rengorgeait, haussant les pieds.
Il avait une tête à descendre au Pall mall Hotel d’Aden, tenu par les riches Parsis.
Parsis, Indiens, soufisme, oromos, afars, somalis. Une mayonnaise de noms, de races, de religions, de noms de bateaux.
Il était temps d’arriver, je commençais à tanguer.
Les maisons blanches de Djibouti sortirent de la brume.
Un câble arriva : « les Houtis tiennent Hodeida ». Un représentant de l’Onu est sur place pour éviter un nouveau désastre humanitaire. Juin 2018 NDLR.
« Au ciel je vois de blanches nations en joie » AR
Au ciel, je vois de lourds nuages noirs s’abattant sur des innocents
Le monde danse sur un volcan.
D’Hodeida, Trébuchet est reparti. Il part vendre son café, alimenter le commerce en mer rouge.
Rimbaud, rétabli, accoste à Aden, un mot de recommandation pour Dubar dans la poche.
J’accostais à Djibouti, hélai un taxi pour me rendre chez Marill, boulevard Marchand.
Marill ! Toyota, Hageisa, Sadiéga, Sagon, Yamamoto.
Cinq cent soixante employés dans quinze sociétés, à Djibouti, en Éthiopie, Somalie, Aden.
Ils venaient d’inaugurer le garage Clemax Yamaha et de présenter la dernière Hilux Turbo automatique.
Il était où, le temps des pionniers que j’étudiais, Joseph Garrigue et Paul Marill, le commerce de la nacre, des boutons, du commerce des trocas, du temps d’Henry de Monfreid, des partenariats avec le flibustier, l’arrivée d’André Marill, l’entreprise artisanale se transformant lentement en société de logistique et de transport, transit entre les différentes terres.
Le plastique remplaça la nacre. On s’adapta. L’entreprise devient le concessionnaire officiel des nippons : Toyota, et toute la gamme des automobiles tout-terrain, motos, des jeeps, des berlines et des camions. À cela s’ajoute, bientôt, les départements des assurances, de la logistique.
ÉGLANTIN
Églantin était là, avec les deux frères Marill, Jerry et Tommy. Très bien reçu, je décidais, au bout de quelques jours, de reprendre ma route, Eg’ était là pour moi. Je voulais enquêter sur des sujets qui me tenaient à cœur, l’université de Djibouti, l’aventure du juge Borell (sur la pointe des pieds), des visites à la bibliothèque Alexandrina, Alexandrie.
Et j’irai glaner des renseignements, au hasard des rencontres.
Partant, je laissai la plume à Eg’ pour sa découverte, ses souvenirs, son séjour chez les Marill, Djibouti et contrées avoisinantes.
J’avais deux missions. Je ne me prenais pas pour un chargé de mission.
Je ne vous laissais pas, l’histoire continuait. Je me sentais rajeunir, le climat me convenant. Le voyage littéraire, dans des contrées inconnues, continuait. Les contacts avec Églantin, avec Biscotte, me seraient facilités par le truchement de mes connaissances à l’ambassade de France, de son consulat, de l’Alliance Française, de l’institut Français, les différentes chambres de commerces et de quelques librairies.
RECIT D’Églantin Basquiast :
Bonjour, chers lecteurs.
Je reprends la plume, je suis Eg, ’ Églantin Basquiast, de New York, le cousin de l’intello de Reims.
Mon cousin est parti vers d’autres histoires, avec d’autres horizons. Content de l’avoir revu, et content si je peux l’aider dans ses recherches, faire avancer son putain d’roman. Il a de la constance, il a toujours été comme ça.
C’est donc l’année des retrouvailles pour tout le monde. Pourquoi ne se revoir qu’aux enterrements, pourquoi ne disons-nous nous pas plus souvent aux gens qu’on les aime, qu’ils nous manquent. Quand la mort les mange, c’est trop tard. Les asticots sont de piètres compagnons.
Je retrouve l’Afrique, Djibouti, l’entreprise Marill.
Je retrouvais avec plaisir ses héritiers, les frères Marill, Jerry et Tommy. Combien d’années nous avaient séparés ?

Je me souviens….outre leurs affaires ils m’indiquèrent qu’ils pratiquaient le parachutisme ascensionnel, participants à des concours d’acrobaties dans le ciel, et, aussi, la photo sous-marine, nageant avec les dauphins et les requins-heureux, les seuls requins qui ne soient pas dangereux. Ils sortaient, de Djibouti au golf d’Aquaba. Plonger pour admirer les plus beaux poissons du monde, mérous, barracudas, murènes, raies à pois bleu, manta aux yeux transparents, dauphins, tortues, requins-heureux, requins-baleines.
Leurs associés tenaient des agences maritimes, pratiquaient la location de voitures et des Manitou, ces monstres pour travaux gigantesques dans les déserts, percements d’isthmes, barrages, forages.
On me présenta Minon Mohamed, chef de l’informatique, spécialisé dans les programmes DIS-PRO IBM, avec des serveurs AIX 4.3. PL., en réseau avec WAN L.S. WINGATE.
« On déjeune à quinze heures. D’ici là Chehem Daoum va t’accompagner en ville, faire un tour. Tu auras un aperçu des transformations de la ville et puis, tu auras à choisir une piaule, une banque, mais y a pas l’feu, tu es notre invité et on est content de revoir l’asticot d’Alexandrie » dirent-ils en s’esclaffant tous deux.
Flanqué de Chehem je parcours les rues de Djibouti, m’imprégnant du nom des rues, mémorisant les immeubles, les commerces, essayant de me les rappeler…cinquante ans ont passé…
But, tout allait bien, je revivais mes années de jeunesse. Le soleil, la mer, l’insouciance, je me souviens…
On passe devant la résidence -hôtel Bellevue, avenue Saint Laurent. Commentaires de mon accompagnateur : bel hôtel, classique mais bien tenu, tu peux y dormir et manger. L’avantage de cet hôtel est sa position centrale, et tu n’es pas loin de chez Marill.
Rue de Genève : discothèque Scotch Club. Les arabes n’y vont pas, ou sur recommandation.
Oui, je connais beaucoup de monde ici. Avant, j’étais croupier au casino Aden Bay.
Mesdames et Messieurs faites vos jeux, rien ne va plus.
J’ai appris en France, chez Patouch’, au casino d’Enghien les Bains.

En passant devant la Salaam African Bank je pense à mon enveloppe, laissée dans le coffre de Marill. À mon regard interrogateur Chelem commente :
Ce n’est pas une banque que je- enfin, nous, (il impliquait le choix de ses patrons) on pourrait te recommander. C’est une banque Islamique, Arabe, pour les Arabes. On s’interroge sur leurs dépôts à terme Islamique, leur carte maitresse servant de passeport, l’accueil interlope qui est fait. À éviter.
Il continua la promenade, m’expliquant que nous avions le temps, les frères Marill recevant, ce matin, des Ethiopiens « pour affaires ».
Ils viennent de l’ambassade d’Éthiopie. Il y a le general manager, Harar Abadar, le responsable culture et patrimoine, Mustef a Hassen, accompagné de son second, Aynb Abdullah Janir.
C’est pour leur projet de médiathèque, au Harar. Ça devrait t’intéresser toi qui aime les livres.
Leur rendez-vous, ça risque d’être long, je te propose d’aller manger un en-cas, chez Youssef, c’est à côté.
Le restaurant chez Youssef, Mukbassa central, restaurant tout en bois, avec des tables et des chaises en plastique, possédait une petite TV qui crachouillait de la musique, au haut d’une armoire.
Souris d’agneau accompagnées d’un riz parfumé, un syrah rosé, une bouteille d’eau des sources du Hagger. Harabara ghost, pun jabi,
Samossa, tous les plats du Yémen. Délicieux, le raffinement dans la simplicité.
« Il y a aussi la Chaumière, pour les grandes occasions. Certainement que mes patrons t’y inviteront. »
Après les cafés forts, brûlants, il m’emmena à la banque recommandée, l’Exim bank, « une banque pour le peuple, vingt ans de service ». Produits bancaires, financiers et vente de téléphones intelligents.
« C’est la banque des patrons, tu peux y aller en confiance. Discrétion et suivis assurés. Petite banque mais grosses affaires. C’est la banque qui choisit ses clients, sur recommandation »
Passant près de l’hôpital il me demanda si je connaissais « le défi du godet de la fistule de glace », recherches sur une maladie rare….mal placée. Mes patrons financent ces recherches.
Ils sont mécènes. Il ne m’en dit pas plus.
L’hôpital Peltier, Baba, Oumar : mes deux zèbres étaient en mission pour la Croix Rouge à Mogadiscio. Au retour ils devaient passer par Berbérah, rejoindre Jonas- boule de gomme.
Mes patrons, mes amis, leur banque, discrétion, recommandation, financement, un hôpital, des hôpitaux.
Les mots dansaient dans ma tête.
Jerry et Tommy Marill
Jerry, le cadet, avec un passé chargé, avait été recadré par le père Marill quand s’annonça le temps de la passation des pouvoirs, le tumulte des affaires, enfin, tout ce que l’on projette dans l’avenir quand on a vingt ans, et qu’on veut « se réaliser » suivant l’expression consacrée. Jerry n’avait pas fait les quatre cents coups ou, du moins, la famille pensait qu’il en avait fait, au moins, trois cents : dettes de jeu (poker), trafics plus ou moins condamnables (fusils) et il engrossait (bad boy au sourire ravageur) les femmes à tour de bras.
L’une d’elle, capacité en droit, souhaitant ouvrir un cabinet d’avocat, sentit la faille, lui déclarant sa grossesse et le condamnant à l’épouser (et tu me coucheras, aussi, sur le bureau du notaire) ; douce pression, intimidation, une fille qui n’avait froid ni aux yeux, ni ailleurs, âpre à la réalisation immédiate de ses projets.
Le père paya la fille et la chassa de l’esprit du gamin. Où l’on s’aperçut, ensuite, que la donzelle se promenait avec un coussin sur le ventre….

Le père se fit rembourser, la menaçant de mettre un contrat sur sa tête.
Pour lui refroidir les idées on envoya Jerry à la légion étrangère de Djibouti, avec recommandation « de bien l’assaisonner ».
Tommy, l’aîné, avait un passé plus lisse. Il était né en Thaïlande, à Uban Rat Chartham. On disait que c’était un enfant naturel, fils de Jacques Vergès, mais rien n’était prouvé, quoiqu’une légère pliure aux yeux quand il souriait pouvait confirmer la légende.
Il avait épousé une Égyptienne qui avait réussi dans l’industrie des cosmétiques, mais le mariage n’avait pas tenu. Un petit garçon était né, Abel, adorable petit métis qu’il voyait régulièrement. La mère et l’enfant habitaient Ismaîlia.
Tommy dit « Le bricolo », tant il était doué pour la chose manuelle, particulièrement la mécanique auto de haute précision était l’homme de la situation chez Marill.
Jerry, le bad boy qui plaît aux femmes, s’occupait des relations commerciales, des contacts avec les entreprises sur le territoire de Djibouti, l’Éthiopie, le Yémen et les deux Somalies jusqu’au bout du bout du cap Gardafui.
Les deux frères abondaient aux sollicitations politiques, Tommy, président de la chambre de commerce, et principal mécène de l’hôpital de Djibouti.
Jerry, lui, était président du Rasqual Club, une association d’entraide aux prostituées qui voulaient sortir du métier et se reconvertir. (!)
Il avait, également, le projet de création d’un golf à Ambouli.
En plus du parachutisme et de la photo sous-marine Tommy avait une passion, les jeux d’échec et Jerry, lui, celle du trial, dans lequel il excellait. L’ancien légionnaire, sportif accompli, donnait rendez-vous aux femmes sur la plage de Doralé où il venait courir, torse nu pour faire admirer ses plaques de chocolat, tous les matins, avant le lever du soleil.
Pour tous les deux la vie était belle : la maturité, un job intéressant, pas de patron, des femmes, des amis, et de l’argent, beaucoup d’argent, énormément d’argent. Ça aide.
Leurs parents disparus ils pouvaient compter, se confier, à Nelly Daubier, la comptable de l’entreprise, l’associée de l’étude Aref Mohamed Aref, d’Ali Sabieh, leur tante chérie, qui les avait pris sous son aile à la mort de leurs parents. Elle les considérait comme ses enfants.
Tout ce petit monde avait entendu parler – de près, de loin – d’Antonin Besse, d’Henry de Monfreid et vivait en bonne intelligence avec les indigènes, et le voisinage.

Je vous raconterai, un jour, les liens qui nous unissent, les Marill et moi, les années bonheur Africaines quand nous avions seize ans, quand nous écumions les casses. Ils m’appelaient le roi de la clé de huit.
L’enveloppe de Biscotte, à déposer à la banque Exim, me rappelait à la réalité.
On évoquait le passé, le présent. Ils me firent parler de toi, l’intello, et de tes scribouillages.
Et d’Antonin Besse.
Les Marills’brothers appelaient le roi du pétrole d’Aden, Tintin mais, je ne sais pourquoi, quand ils en parlaient, des lueurs passaient dans leurs yeux, ils hésitaient à caser les mots. Du temps avait passé.
Mes pensées vagabondaient ; les frères Marill à Djibouti, les juristes Américains à Aden, la crosse du révolver dépassant du tiroir de leur bureau.
Plus loin, aussi, ce que l’intello m’avait raconté dans ses écrits, Lucereau, transpercé d’une lance sur le chemin de l’Ogaden, Monfreid tuant un homme de sang – froid, les gens du cinéma, Claire Denis et Beau travail, Denis Lavant, au vieillissement des albums hâlés par le soleil, ou bavés à la mer. Les albums de photos des filles que l’on n’a pas eues.
Il me fallait me réveiller, voir le soleil en face, ne pas ciller.
Les parois de mon cerveau étaient aussi fines que la frontière qui séparait Loyada du Somaliland.
La nuit je rêvais : j’étais barman dans un bar d’Aden fréquenté par les légionnaires.
« Alors tu étais dans l’infanterie de marine, ben, tu es comme moi, on est tous les deux de la coloniale ». Et de fêter ça en échangeant force toasts à la gloire de l’armée, des Picon-bière, rappel de son temps à Blida.
La température montait, il parlait des femmes et de la Légion, sa deuxième famille.
Et puis il me parla, aussi, de Monfreid, qu’il admirait. « Je sais, je sais, on l’a accusé de trafics de toutes sortes, haschich, armes, esclaves. Et puis il y a l’histoire de l’indic qu’il a amené, de nuit, sur son boutre, pour le supprimer, c’est vrai mais ça, c’est les aléas du métier ; pour moi il est, il reste un héros, un homme, un vrai ».
Il me parla d’un général qui avait des documents à me remettre, sur la fuite de Rimbaud en Afrique (c’est ce que tu cherches, non ?) un catalogue des retournements de Monfreid, devenu ami-ami avec les armées Italiennes occupantes, des choses un peu compromettantes.
Il parlait, de plus en plus fort, de plus en plus vite.
La chaleur devenait insupportable dans ce boui-boui. Les vapeurs d’alcool montaient. S’ajournaient les brumes qui s’élevaient de la terre. Un brouillard.
« Tu fais ton paquetage, man, retour Djibouti, on va te former aux combats, te déformer la caboche, te faire passer tous tes permis, ton brevet colonial. Après, t’es des nôtres. Vive la coloniale ! (il avait les yeux injectés de sang). Au cap Gardafui on te lâche, ton trip c’est de descendre dans la fosse nourrir les requins. On en fait l’élevage. Puis tu vas faire le garde-côtes, au phare. C’est désert et un peu chaud. Tu sais te servir d’une kalachnikov au moins, péquenot ?
J’étais dans un four.
Les tonneaux de bière éclataient, les uns après les autres, trop de pression.
Les pirates envahissaient la salle, je sentais déjà leur couteau dégoulinant de sang sur ma gorge. « Coupe-lui les couilles, il courra plus vite ! Et qu’il fasse attention à ses arrières, c’est tout c’qu’i lui reste ! J’suis mort de rire ! ». En place de tête du légionnaire c’était une tête de singe hurlant, un singe énorme, sautant sur moi.
Je m’éveillais, dégoulinant de sueur.
Au soleil il était midi moins le quart.
L’intello m’envoyait le double des courriers reçus.
« Ba ba ba ba ba, disaient les lecteurs putatifs. Vous n’avez qu’à aligner les mots et Ils formeront des phrases. Vous évoquerez, les jours suivants chez Marill, la banque pour l’argent, l’hôtel pour dormir, la découverte du garage, leur proposition de vous remettre à la mécanique,
La découverte de contrées à explorer, d’expériences à vivre.
Et puis, n’oubliez pas votre contrat : écrire sur et pour Besse ; rappeler Monfreid (il ne dit pas être loin). Pour Riès, Tian, ne pas déranger ; leurs affaires les mènent au Moyen-Orient, nouveaux clients, perspectives et affaires. À voir, plus tard en rouvrant les carnets de ce damné Ardennais. »
Tout ce verbiage me semblait bien plat et, surtout, inutile.
Surtout, n’oubliez pas ce que vous faites, où vous êtes. Ne vous égarez pas, ne vous dispersez pas.
Leurs paroles s’évanouissaient dans les vrombissements les camions jetés sur les pistes et traversant les villages à toute allure, soulevant des montagnes de poussières, accompagnées par des nuées d’enfants les poursuivant aux cris de « Aroum Takem ! Aroum Takem! ».
Et puis les chose se planifièrent.
J’avais trouvé l’hôtel, la banque et j’étais invité, en toute fraternité, par les Brothers Marill. J’étais de la famille, comme avant, mieux qu’avant.
Un séjour plein, que je ne regrettais pas, une échappée. New York, Chrysler, étaient loin.
On pense aux bons moments que l’on garde en tête, et que l’on met de côté dans sa mémoire, quand les choses se désagrègent et que l’on cherche à faire le point sur sa vie. Qui ne le fait pas ?
Les dîners avec mes potes se passaient sous la véranda dégorgeant de campanules et de chèvrefeuilles, en compagnie d’invités, des Français, quelques Indiens, à causer de tout, de rien, en toute liberté. Les mets et les vins, généreux, me rappelaient la France.
L’argent restait dans la banque. Je restais à l’hôtel.
Les filles-fleurs dressaient les nuits. En elles, le temps s’écoulait. Je ne pensais à rien, en attente de l’aurore, d’un nouveau jour. En vacances.
Les filles-fleurs, je repense à leurs sourires, leurs yeux mangés par le khôl. « Peut-être connaissent-elles les secrets du monde ? » AR.
Enfin, je m’ébrouais, passais au garage. On me fit visiter. Énorme entreprise, avec les derniers cris de la technologie.
« Alors, le lézard, me lança Jerry, on s’y remet ? T’as pas peur de mettre tes jolies mimines de post-écrivaillon dans le cambouis ? T’es toujours le roi de la clé de huit ? »
J’exposais mes projets, ceux de mon cousin, et puis la joie de se revoir ravivait le présent. Je désirais des intervalles, revoir le pays, les pistes, me remettre à la mécanique, ma passion, ces intervalles permettraient de….
« T’en fais un beau d’intervalle, trou du cul. J’ai parlé à Tommy. Ça te dirais de te replonger dans la mécano, écouter les moulins. En allant réparer nos monstres aux quatre coins de la république de Dji, tu pourrais avoir des contacts – clients, fournisseurs – et glaner des renseignements sur Tintin. Qu’en dis-tu l’asticot ? Puis me dévisageant » T’as pas changé.
Des rêves plein la tête, des outils pleins les mains, à user ta jeunesse sur les bancs, les expériences de la vie. Tiens, v’là t’i pas que j’use de ton langage poudré ! Allez va voir Ahmed, le chef d’atelier, il va t’causer. En tout cas, tu as toute notre confiance, à Tommy et à moi.
Bienvenu au pays des Afars et des Issas. Tope là ! Avec une claque dans le dos. « Il me quitta, mandé par le responsable des stagiaires.
Une nouvelle vie commence. Comme le chat à neuf queues peut-être avais-je neuf vies ?
Écrivaillon, mécano, bibliothécaire, baroudeur. Où sommes-nous ? Dans quelle vie ?
New York, Reims, Djibouti. On repasse les plats ?
Quinze jours passèrent.
J’étais à ma main, j’avais ma main, à turbiner.
Quelques travaux sur le Hilux 2009, un différentiel avant sur un diesel japonais, m’aguerrit sur les nouvelles normes des technologies. L’informatique avait pris le pas.
J’étais dans mon monde. Le bleu de travail marqué d’un MARILL INGENIERIES, neuf, m’allait comme un gant.
Après d’autres prémices – une panne de démarreur – le relais de préchauffage des bougies faisant des siennes, le démarreur on le démonte, les charbons, les chemises, les radiateurs et autres culbuteurs.
J’attaquais la route, l’aventure.
Les Ingénieries’Brothers m’envoyèrent à Dikhil, au garage Adil-Turquie, un sous-traitant à eux, pour donner un coup de main. « Mais t’es pas obligé, tu sais ».
J’étais heureux. Je revoyais mon pays.
DIKHIL

Dikhil, à cent kilomètres de Djibouti, à dix de la frontière Ethiopienne, rafraîchi par l’oued
Chekkeyti. Une seule voie, la nationale 1, de Galafig à Djibouti.
Adil, petit patron chaleureux du garage, m’accueillit. C’était un ancien de chez Marill qu’il avait quitté pour monter sa propre boite. Il avait gardé d’excellents rapports avec ses anciens patrons. On se rendait service. Pas d’ombre à l’Orient, ses conventions, ses rapports humains, amours et détestations. Et le respect.
Dikhil, fragilisé par son voisinage avec l’Éthiopie, avait reçu le soutien de l’armée.
On avait construit un fort, la milice s’y était installée.
Autour d’un café il prit le temps d’installer la conversation, me contant l’histoire de la ville, le souvenir du commandant Albert Bernard tombant en embuscade à Moraito, près du lac Abbé, avec quinze de ses hommes, tous égorgés, en voulant porter secours à des réfugiés Issas.
On en vînt à parler de ma visite, de mes connaissances, habilité par la famille Marill.
« Comment ont-ils ? Que devient Jerry le flambeur ? A-t-il ouvert son golf ? Et Tommy, comment va son petit garçon ? ».
Les deux frères m’ont expliqué, qui vous êtes, ce que vous êtes….il s’arrêtait, guettant les confidences.
Je devinais les questions sur la face ridée d’Adil.
Je nommais Rimbaud (le Frenchie qui courait l’Ogaden à cheval), Monfreid (un drôle de type.)
– J’ai connu Armgart, sa femme, quand elle travaillait à la léproserie du Harar. Il ne la méritait pas). Enfin, Antonin Besse (son visage se ferma).
Il m’a demandé d’écrire un livre sur lui. Je rallumai l’intérêt.
« Écrire un livre sur M. Besse, vraiment ». Il détachait les mots, les soupesant, essayais de me faire passer un message. Et, aussi, des lueurs dans les yeux, comme…..
Puis, nous rendant à son garage, bien rangé, il continua la conversation.
« Vous auriez pu…il s’arrêta, me dévisagea, cherchant ses mots. » Vous auriez-pu écrire sur d’autres thèmes, l’origine des colonies de ce côté, de l’influence du climat sur les populations et sur les machines, les automobiles, cela n’a jamais été fait, me dit-il, regardant au loin.
Il reprit : et un livre sur les aventuriers, qui s’en sont allés, qui ne sont jamais revenus.
Ouvrant la porte de l’atelier il me glissa : « je suis le fils naturel de Lucereau ».
Il s’égaya devant les bolides de ses clients, des français qui avaient réussi.
« Vous savez, Lucereau le transpercé, reprit-il avec un sourire triste.
Il passa à autre chose, ajoutant :
J’ai les connaissances pratiques en automobile, bien sûr, mais plus de main d’œuvre, ni de pièces détachées. Certaines de ces marques renommées sont, plus ou moins, en attente. Les clients attendent, j’attends, mais vous savez, vous êtes en Afrique, en Orient, le temps ne compte pas ».
Il avait retrouvé sa gouaille, sa simplicité, sa bonhomie. Il me donna les instructions et me laissa.
Je me mis au travail.
Personne dans l’atelier, ni dans les parages.
Je me penchais sur un problème d’excitation de vis de démarreur. Le véhicule calait, subissait une baisse de régime. On n’avait pas touché au Neiman. Je vérifiais les contacts, où se positionnait la fixation des câbles, les cosses de batterie. La tension des charges de batterie était faiblarde. Contrôle des 12 V associé au démarreur. Enfin, après le filtre à gasoil nettoyé et m’être occupé de la connectique, tout devait rentrer dans l’ordre.
Contact. Le moteur ronronne. Je laissai un peu de temps au temps, accélérait, modérait. Les cliquets devaient se remettre en ordre avec les pistons, en douceur.
Le fils naturel de Lucereau ! Ah ! Ben, dis donc !
Son visage émacié sur la neuvième photo, montrée par l’intello, la terrasse de l’hôtel de l’Univers, Aden.
Je n’avais pas de réponse à la question « est-ce que les morts rêvent ? ».
Je fus sorti de mes ébahissements mystiques par Adil.
« J’ai entendu le moulin repartir. Ça marche ? Mon client va être content. C’est Hassan Gould Aptidon, le président de région, féru de belles cylindrées.
Vous pouvez vous pencher, maintenant ou après le repas, sur une autre voiture. Je voudrais votre avis.
La Toyota Hilux Vigo 2.5 STD était l’une des dernières acquisitions de chez Marill.
« J’aurais besoin d’un injecteur de carburant diesel avec pompe DENSO ; Il n’y a que les britanniques qui en ont, paraît-il.
« Et puis, aussi, il me manque un arbre de transmission Toyota Hilux 4 x4 37140 – 35030 en 610 mm.
Enfin, et si vous avez le temps, j’aimerais votre avis sur la dernière Toyota sortie, l’Hilux
L’invincible, personnalisée, moulée à la main, avec tapis caoutchouc. Mais, peut-être vous avez du chemin à faire et vous pensez rentrer avant la nuit ?
J’avais besoin d’une douche, d’un verre et lui proposais, ensuite, de manger un morceau
« Aux deux gazelles » le resto côtoyé le midi, et qui faisait hôtel. Je me coucherai de bonne heure et me rendrai à Ali Sabieh, chez Kadar Al Diranem. C’est à un jet de pierres.
– Je le rencontre pour des dépannages, et puis, aussi pour des conseils. Il veut se séparer d’une partie de sa flotte et il a des soucis d’’informatique.
Repas pris en commun avec Adil qui parle plus qu’il ne mange. Il me narre son passé, sa vie de militaire chez les Français, son apprentissage de la joaillerie, la connaissance des métaux précieux. Avait-il connu Schouchana ?
Il avait vécu longtemps en Érythrée, à Asmara. La parenthèse Italienne lui avait donné le goût de l’histoire. Il connaissait par cœur les aléas de l’aventure de Mussolini et de ses chemises noires. Aussi noir que leur cœur, ajoutait-il.
Et Monfreid ? Questionnais-je.
« Ah, Monfreid….»
Il se tut, puis : « il était très aimé de ses hommes qui se seraient fait tuer pour lui ». En disant ces mots j’avais conscience qu’il cherchait à s’en convaincre lui-même.
« Avez-vous connu Chapon-Baissac », me demanda-t-il, tout à trac.
J’en étais à mon deuxième whisky Johnny Walher, un whisky Coca servi dans un magnifique verre de cristal de la collection Wallace, de Londres, un luxe incongru dans ce garage sentant l’huile de vidange, un verre de cristal creusé à la main avec le liseré du célèbre bleu Wallace. J’y étais passé en 1954, une boutique adossée au Montaigu Square où avait été tourné le film « Brève rencontre », je me souviens. Je me perdais dans mes pensées. Je pensais à mes correspondants, à l’intello, son éditeur, ses lecteurs. Allaient-ils devenir les miens ? Une sorte de dédoublement me prenait ou, plutôt, un dédoublement de périodes. De saisons ?
Ces digressions ne me semblaient pas pesantes. J’étais en Afrique, en Orient, dans un autre monde, dépaysé et curieux de ce dépaysement.
Je n’avais pas à pondre un mémoire me permettant d’entrer au Royal Institute du Pen Club, mais plutôt, pour donner un coup de main à mon cousin. Pour moi, tout s’imbriquait.
Les fauteuils de cuir des clubs Londoniens s’avachiraient, usés par le temps, avant que mes petites fesses ne reviennent s’y poser.
La cigarette king size d’Adil se fumait toute seule, la cendre tombait sur la nappe.Il me racontait l’histoire de Lawrence d’Arabie. Il avait connu son biographe, Alistaire Mac Lean, l’auteur des « Canons de Navarone ». Laurence rêvait d’une Arabie indépendante, nous renvoyant aux accords Picot, nous renvoyant aux guerres, le méli-mélo de la Syrie, des guerres intestines au Yémen, en Somalie, partout, d’une mer à l’autre.
Adil avait servi sur le Humber, le bateau-école de ravitaillement anglais à Akaba, en 1917.
Il avait accroché, au-dessus de son bureau, le fusil Lee Enfield, ayant appartenu au colonel Laurence. Il s’en servit lors de la campagne du Hedjaz, en 1916.
Adil se souvenait du 4 juillet 1922, date à laquelle Laurence rendit son tablier en démissionnant du bureau des Affaires coloniales. Il l’avait accompagné au cercle, au Caire, dernière présentation, en costume Arabe, devant un quarteron de politiques, ambassadeurs, généraux.
« Que la nuit vous soit douce, qu’Allah vous accompagne, vous guide, dans vos occupations, vous protège. »
Les rapports circonstanciés de ma visite, bons de commande et rapports furent bourrés dans le suite-case neuf, en peine peau de chèvre, un objet qui allait m’accompagner dans mes tournées Marilesques.
Je me couchais pleins de rêves, de pensées, le corps prêt à se détendre (si le cerveau pouvait en faire autant !) avec, encore, en bouche, le goût des merveilleuse pâtisseries Orientales dont je m’étais goinfré.
Demain, Ali Sabieh.
(Depuis mon arrivée à Djibouti je tenais un journal, rangeais les courriers reçus de New York, relisais les missives du cousin.)
Et le monde, comment va-t-il ?
Le monde, il va, monsieur, il va.
ALI – SABIEH

Ali-Sabieh, Calisablix en arabe, deuxième ville du territoire, à 90 kilomètres au sud de Djibouti, 10 de la frontière Ethiopienne. Ali-Sabieh, ville de la fin de la mission Marchand, de Jules Maral de Coppet, administrateur de la ville, protestant, franc-maçon, ami d’André Gide et de Roger Martin du Gard (dont il avait épousé la fille).
Ali-Sabieh, le garage de la bonne Etoile, appartenant à un groupe Britannique, le Curtis Booth limited, 61 Exmouth Market, Londres. Son gérant, le patron, Fazio Szabo, me reçut avec tous les salamalecs habituels.
C’était un grand type, en vareuse claire, un Européen habillé en Européen.
Il vous toisait de haut, avec un regard en bas. Jerry m’avait expliqué le personnage, son malheur, sa femme et sa fille noyées dans un naufrage sur un bateau en partance pour l’Inde.
Depuis le drame il avait changé de cerveau, passait ses journées libres au bord de l’Océan, parlant aux pêcheur, scrutant l’horizon, se mêlant aux indigènes dont il partageait les repas. Il les avait apprivoisé, avait rendu de menus services, ne s’imposait pas.
Les habitants connaissaient son histoire, le laissait tranquille. Certains l’avaient invité dans leur modeste maison.
Le garage était flambant neuf, moderne, aéré « On a tout refait, dernièrement ».
C’était un garage avec la vitrine d’un concessionnaire.
L’homme était doué pour les relations d’affaires et, après quelques moments de découverte, ne vous toisait plus de haut, n’avait plus de regard sournois et devenait presque affable.
On m’a envoyé chez vous pour…
Oui, je suis au courant, vous êtes recommandé par le groupe Marill. Je vais vous expliquer.
Il expliqua.
Il avait à vendre un Toyota Hiace Multiborn Marill, robuste, intérieur nickel, installation inox moteur 2 l. Il avait un client qui en voulait 2 000 000 de francs Djibouti.
J’ai, aussi, une proposition de matériel informatique, une offre à 120 000 francs Djibouti pour une Maxbox pro 2013 13 pouces. Opérationnel, une touche manquante. On peut le voir ; le propriétaire vous adresse les images par Whatsapp.
Voilà ce que j’ai à proposer, à proposer aux frères Marill.
Comment vont-ils ? Il y a bien longtemps que je ne les ai vus. Son regard se perdait au loin.
Il ouvrit la bouche, me regardant, mais s’abstint de conclure.
Par la fenêtre on voyait des chameaux passer, conduits par de jeunes garçons.
Fazio me faisait penser un peu à Jean-Pierre Mariel, un peu dégingandé, un peu désabusé, mais prêtant totalement l’oreille. Un commercial à l’ancienne.
On m’a parlé de vous, vous êtes seul. Vous baiser les filles du « Poisson d’Or », près de chez Marill ?
Estomaqué, j’attendais la suite.
Il partit d’un long rire silencieux.
Ne m’en veuillez pas. On est entre hommes. Vous, vous êtes loin de la France, moi, loin de mon Italie natale. Il ajouta « Italien, mais ne me parlez pas de Mussolini, s’il vous plaît. »
Nous déjeunâmes au premier étage d’un grand restaurant en spirale donnant sur un superbe point de vue « l’Éthiopie, c’est là, au bout de votre nez ».
Il était content de fréquenter un Européen.
Entre le poisson grillé et le délicieux gâteau fondant il m’expliqua qu’il était heureux ici.
Je me taisais.
Et, tout à coup : – je sais que vous venez de chez Abdi, le fils de Lucereau, ce français imprudent. Et moi, qui suis-je ?
Je touillais mon café plusieurs fois me demandant si cet Italien n’allait pas m’annoncer sa lignée directe avec Hailé Sélassié !
Avant, il y a bien longtemps, quand j’étais jeune, j’étais infirmier de la Croix Rouge dans un programme de coopération internationale, au Harar et là, je n’y ai pas connu Rimbaud, bien sûr, mais….
J’étais suspendu à ses lèvres.
Il me sortit délicatement une photo de son portefeuille.
Baba ! La fille d’Armgart et d’Henry.
Où croyez-vous être ? Êtes-vous à ce que vous faites ?
Son regard me perçait.
Qu’êtes-vous venu chercher en Afrique ? On vous a dit de ne pas vous disperser.
Allons, allons remettez-vous, vous avez l’air complètement abattu….
Baba, à Araoué, ou Baba, la petite-fille à l’hôpital Peltier. On m’a raconté l’odyssée d’un français au Cap Gardafui, son hospitalisation à Berbera. Vous le connaissez ? (forme interrogative) puis, vous le connaissez (forme affirmative). Vous êtes en Afrique, en Orient, cher monsieur, pays des légendes, des sortilèges. Le climat, la religion, les traditions, la place de l’homme, de la femme, sont différents de l’Europe d’où vous venez. (Je ne lui parlerai pas de New York, mon port d’attache)…). Tout se sait ici, on s’ennuie tellement « que je m’ennuie, que je m’ennuie », vous connaissez cette petite phrase, n’est-ce pas ?
Puis, tout à trac :
Avez-vous des nouvelles de Lucy ?
Lucy ?
Oui, Lucy, la plus vieille femme du monde retrouvée dans la terre Ethiopienne.
La tête me tournait.
Vous connaissez Théilard de Chardin ?
Mais bien sûr, que croyez-vous ? Dites-moi….
Spontanément je lâchais mon nom, mon âge, ma profession, ma ville natale.
Ça correspond bien à nos fiches, mon petit monsieur……

J’avais envie de reprendre l’avion immédiatement.
Qui était ce maquignon ? Un défroqué de l’histoire, un espion, un passeur ?
Le mieux était de ne rien laisser paraître, de continuer à touiller le café – maintenant froid – tandis qu’il évoquait, maintenant, la mission Marchand.
Trois cafés plus tard, il ravivait l’Histoire.
La mission Marchand.
1896 – 1899 Douze Européens, cent cinquante tirailleurs.
6000 kilomètres, du Congo au Soudan, à pieds (!).
Après la mission, Marchand, Jean-Baptiste de son prénom (comme votre Colbert, ce Champenois, baptisé Le Nord par Mme de Sévigné je crois) et puis, et puis il retrouva l’affaire Dreyfus pour…..
Mes yeux se fermaient. Il avait mis quelque chose dans mon café ?
Le bourdonnement continuait …
Vous vous imaginer, comme Albert Baratier, l’un des participants, marchant dans la vase, évitant les racines et les roseaux coupants
…. Bien sûr, il y avait un médecin colonial.
Ils repartirent en France, se faire trouer la panse dans les combats de l’avant-dernière guerre, comme le petit Pierre-Félix Fouque tuée d’une balle dans le thorax le 23 septembre 1914.
Alfred Dyé était le commandant du Faidherbe pour la navigation du Congo au Nil. Les bateaux vont sur l’eau pas sur la terre. Combien de fois dit-il désosser son bateau pour le faire passer……on devait démonter les deux chaudières (elles pesaient deux tonnes) pour les réarmer, les emmener sur des chariots, vous voyez ?
Et puis, le sergent Bernard, son képi blanc de la Légion, un rêveur, une médaille pour services rendus.
À Ali-Sabieh nous avons des célébrités, Mahamoud Harbi Farah, qui gagne tous les marathons. Je l’ai accompagné à celui de Paris, avec ses cousins, Hussein Ahmed Salah,µ
Aden Robien Awaleh.
À Djibouti vous allez connaître Nima Djama « Baw-Baw », une révolutionnaire (elle s’est calmée, elle voulait chasser tous les Européens). Elle tient, maintenant, la B.I.D., la banque Islamiste pour le développement. Sa sœur, Nerma Djamis Migel est connue pour avoir lancé le premier système de micro-crédit pour les intouchables, à Bombay.
L’Italien, allait-il se taire ? Pouvait-il se taire ?
Je sombrais, la tête dans les bras.
Il me réveilla.
Partez maintenant, vous avez des kilomètres à faire jusque Djibout’. Dans deux heures la nuit va tomber brusquement et vous serez dans la nuit avec les voleurs de grand chemin et les hyènes. Pour la route, vous n’avez pas à vous tromper, il n’y en a qu’une sur la capitale. Je vous ai fait le plein, préparé un en-cas, un jerricane d’eau, et j’ai donné de vous nouvelles à Jerry le malin et Tommy l’industrieux. « Votre commis-voyageur est sur la route du retour.
« Dans cette pochette tous les documents concernant mes demandes aux frères Marill, photos, devis. Il ne me reste qu’à vous souhaiter bon retour. Portez-vous bien.
Je vois que vous ne supportez pas le café Cocox, mais vous vous y ferez.
Ah ! J’oubliais, qui je suis ? Je suis le descendant de Villiers de l’Isle Adam, mais de la main gauche. Et puis, la Champagne, Reims. Mes arrières grands-parents tenaient le café du « Grand Veneur, en face de l’hospice Saint Maurice. Partez maintenant, il est temps.
Je me passais la tête sous l’eau et regagnais mon habitacle.
Je reprenais la route, passant par Daasbiyo, Hol-Hol, Chabelley. Dans les lacs les crocodylus nylotyctuss s’ébattaient. Des Erytrobus palas traversaient la route en criant, en bandes.
Je passais les barrages des Américains, Chinois, Français. Le nom de Marill servait de passe, le superbe Toyota en imposait. Certains me faisaient le salut militaire.
Tout à coup, la nuit tomba.
Souvenez-vous de qui vous êtes, où vous êtes. Ne vous dispersez pas.
Le clavier fumait.
À la réception de l’hôtel m’attendaient un paquet et une lettre.
Le paquet contenait le dernier sprint Samsung Galaxy Noté Turbo
« avec notre bon souvenir, signé Jerry et Tommy.
La lettre, datée du 25 mai, provenait de Calcutta. En bas de la lettre :
P/O Brix Laurent / Antonin Besse / AYABAJA director for collector A.I.I.F.
Queen street / Bar wharehouses 325 Calcutta NPO
Cher monsieur,
Comment allez-vous ?
Nous avons rejoint Aden hier.
La cargaison a bien été réceptionnée, retour en transfert du Harar.
Voici quelques points à retenir :
Nom du donneur d’ordre, nom de la banque
Accompagnement du bordereau
Règlement de la facture code » HOP Versas 12 » Switzerland A
Nom imprimé de l’entreprise suivant les règles internationales
Nombre de pages, de photos, des documents, en finalité officielle
Poids du papier, en-tête, format et nombre de copies calibrées pour l’Europe
Déclaration douanes, aval des autorités
Photocopies des passeports, aval des chambres consulaires
J’avais beau retourner la lettre dans tous les sens je n’y comprenais rien.
Je ne retenais que les noms : Brix Laurent, Antonin Besse, les villes : Aden, Harar, Calcutta, le pays : la Suisse. Me voilà bien avancé.
Je repensais à mes interlocuteurs à Djibouti, Dikhil, Ali-Sabieh : « on vous connaît, on sait tout de vous.
Je ne pouvais pas me cacher. D’ailleurs, je ne le désirais pas.
Rimbaud, Monfreid, avaient passé le relais à André Gide, Roger Martin du Gard, Villiers de l’Isle Adam et, bientôt, pourquoi pas, Alphonse Daudet et son moulin !
La curiosité me faisait avancer.
J’interrogeais les étoiles, la nuit d’encre.
« Debout les bleus ! Branle-bas de combat ! Jerry, en short, était au pied de mon lit, imitant le trompette trompetant l’appel de Diane.
Je me rappelais les paroles que l’on apprenait aux bleus-bite pour souffler dans le cornet, en harmonie : « la bite à papa que l’on croyait perdue, c’était maman qui l’avait dans le cul ». On avait vingt ans. On découvrait le monde, ses turpitudes désirées.
Vingt minutes plus tard, douché, aseptisé, j’étais à la table de mes deux lascars.
Bien dormi ? Seul ?
Jerry me regardait en riant. Adepte des romans de OSS 117, les doigts dans le pot de confitures, il engloutissant des croissants, voilà qu’il me récite un passage du bouquin :
« Dur dur de se bagarrer à poil. Mon intégrité en prenait un coup, l’autre en profitait… Je l’expédiais d’un crochet du droit, soufflais puis rejoignais ma couche. Une jeune beauté y était installée. J’avais besoin de repos, j’étais claqué mais cette reine de la nuit entreprit de me faire revenir à la vie en se pressant contre moi. Je sentais ses doigts effilés descendre sur mon ventre. Elle sentait la vanille.
Alors, fais-voir, tu bandes ?
Maïté, la nounou Malgache, gouvernante des deux garçons sourit furtivement en me regardant. Elle en avait entendu d’autres. Elle les servait depuis leur naissance.
À voix basse, en aparté, se tournant vers moi : « Deux bons garçons, libres, libérés. Ils ont connu bien des malheurs mais leur connivence, leur solidarité familiale, et l’envie de réussir, avec de saines ambitions, les ont écartés des mauvais chemins.
« MERCREDI 27 JUIN 2018. L’Arabie Saoudite bombarde Hodeida, reprochant aux belligérants de faire passer leurs armes par ce port Yéménite.
Par où passe l’aide humanitaire porté par les O.N.G. ? NDLR

L’intello devait être à Hodeida pour visiter les usines de Besse, éplucher les états de santé de Rimbaud, collaborer avec Trébuchet, salarié de la boîte concurrente de celle de Bardey. Enfin, faire virtuellement sa connaissance, mais par où passer ?
Pendant que l’Arabie Saoudite joue à ce jeu dangereux, les seigneurs de la guerre, Yéménites, se réunissent sous les tentes avec leur tribu.
« Le peuple souffre, pas de nourriture, pas d’hôpital, pas de médicaments.
Les hôpitaux d’Hodeida, Berbera, Sanaa, Djibouti, Aden, Mogadiscio lancent, depuis leur toit-terrasse, des messages à Dieu, à Allah, au monde, désespérés. NDLR
Au petit déjeuner la conversation devînt studieuse.
Ils me demandèrent si la Toyota, leur cadeau, me satisfaisait, quel ressenti de l’accueil sur mes visites des garages dans le sud de Djibouti.
Tout cela, sans avoir l’air d’y toucher, en balayant les miettes sur la table.
Les documents officiels, factures, projets de mes deux garagistes, ils les avaient sous le coude.
Sans arrêt des employés passaient dans la salle, remettant des clés, des papiers ; certains venant chuchoter à l’oreille des deux frères.
Dans la cour des camions arrivaient, partaient, des indigènes entraient dans la cour avec des ânes. Livraisons, fournisseurs et tout le tintouin, la routine, m’informait Tommy levant mes interrogations.
Le groupe Marill, un empire à comparer à celui d’Antonin Besse ?
« Eh, mon gars, encore un peu de café, j’te l’arrose de brandy 1er choix, gôute-moi ça.
Prends ton temps ; tu m’as l’air tout débarbouillé d’idées et de songes. C’est le contraste, le pays. T’es arrivé, voilà tout.
Une bonne nuit là-dessus, un câlin crapuleux avec une copine, une claque su’l’cul et çà roule ! Tu pourras reprendre le chemin, le chemin des écoliers, la route de Damas, la voie pavée ou non de bonnes intentions.
Vas-y l’asticot. On a vu qu’tu lisais « les quatre saisons à l’hôtel de l’Univers. Ça t’inspire ? T’es quand même un putain d’intello, comme ton cousin, avec des idées, des scribouillages.
Que devient-il ? On t’aime bien quand même et tu t’es bien débrouillé à Dikhil, mec. T’as fait du bon boulot. «. On aime bien aussi ton cousin, juste entrevu. Belle famille !
Il riait, donnant une claque sur les fesses d’une servante qui débarrassait.
Ils connaissaient mes lectures. Fouillaient-ils, ou faisaient-ils fouiller mes bagages ?
Deux célibataires, le monde est à eux.
Les rollings stones, les pierres roulantes (jusqu’à où ?) des frères Marill me laissaient dubitatif. Étaient-il les mêmes, connus dans ma jeunesse ?
Je serrais papiers, courriers, documents, cartes.
Taillé pour l’aventure, disaient-ils.
Je repensais au militaire rencontré : Monfreid a tué un homme, c’était un accident. Il s’en ait payé des femmes, vous savez ce que c’est, dans la coloniale, on ausculte les tempéraments des belles indigènes.
Les B.M.C. bordels militaires de campagne se transformaient en palais des mille et une nuit. Monfreid avait occis un concurrent mais ne l’avait pas fait exprès.
Les indigènes récalcitrantes se faisaient violer. Dûs, trophés, impérialismes, soudards.
N’oubliez jamais qui vous êtes, ce que vous valez, d’où vous venez ………
La vie était-elle une vallée de larmes s’imprimant dans les souffrances, les douleurs, les hontes, ou bien une vallée de roses où coule le lait et le miel, où les femmes s’ouvrent comme des corolles, un pays où il n’y a qu’à se baisser pour ramasser l’or. La dualité, la balle qui roule sur le filet. De quelle côté va-t-elle tomber ? Chez moi, chez vous ?
Après la guerre, les infirmes, les amputés, les gueules cassées, cherchent leurs victoires en comptant leurs membres. Ils vont d’une vie passée à une vie présente, oubliés (non rentables, exclus). Présenter l’addition.
Les braves gens suivent leurs routes.
Vous n’avez servi que les intérêts des autres.
Une missive de mon cousin parti à Hodeida……
Qu’allait trouver l’Intello à Hodeida sous les bombes, les bombardements, l’usine d’Antonin Besse ? L’hôtel où séjourna, brièvement, Rimbaud, pour se requinquer, se remettre de son insolation, sa conversation avec Trébuchet ?
Mes lecteurs ricanaient : « Pauvre fou ! Vous rêvez, il n y ’a plus rien, le peu qu’il restait vient de disparaître. Allez-vous faire charcuter là-bas, si cela vous chante.
Mourir, pour des recherches, une envie, un contrat, un rêve éveillé, entre absurdité et réalité, la dure réalité du terrain. »
Je les entendais déjà, les autres, les poursuivants : « vous ne connaissez pas les lois du marché, le partage des eaux internationales, les fièvres qui prenaient les colons, aventuriers, commerçants sous leur casque plombé colonial. Vous devriez stopper, rentrer chez vous, passer à autre chose. Pourquoi écrivez-vous ? Passer les quinze années qui vous restent à vivre à voyager en de luxueuses croisières, fréquentez les palaces comme si vous aviez réussi, sauvé, et donnez le change, et donner la pièce au garçon de cabine.
Mentalement il notait que Rimbaud ne portait pas le casque plombé colonial. Dans ses dangereuses virée dans l’Ogaden il se vêtait comme un arabe, se serrait la tête d’une serviette.
Cinq heures du matin. Je vais rejoindre mon cousin à Hodeida. Mon passeur vient me chercher à l’hôtel, accompagné de deux gardes du corps, d’un interprète qui fait office de chauffeur et d’un cuisinier.
Dans la jeep qui nous emmène au port je remarque les vivres, l’eau, les kalachnikovs, une radio, des jumelles. Abdi, le chauffeur, me tend une lettre des Marill.
« Salut, p’tit haricot. On ne peut t’accompagner au port, nous partons, avec Tommy, pour Bombay, on nous réclame là-bas, une livraison urgente, grosse commande de 4 X 4 chez nos amis Indiens.
Tu as tout ce qu’il te faut…..pour essayer de rentrer vivant à Dji, toi et ton cousin, les hommes, le matériel. Dans l’enveloppe on t’a mis des roupies et des dollars. Distribue-les, sois généreux avec tout le monde.
Connaissant ta caboche tu ne nous aurais pas écouté sur les rapports sur l’actualité d’Hodeida. Là-bas, ça craint.
Bombardements continus, les O.N.G. débordées. Hôpitaux détruits.
Prudence, on veut vous revoir tous les deux. Tommy et moi on vous aime, (mais ça n’ira pas jusqu’à se faire péter la rondelle !). Faites pas l’con, si ça chauffe, vous revenez.
Qu’Allah et le bon Dieu veillent sur vous, qu’ils répondent à vos désirs.
J. § T. Marill
PS On rentre le 27. Mama Maïté fait la jonction à Djibout’.
De Djibouti à Hodeida il y a 202 miles marins ; en allant à dix nœuds on met une journée.
En arrivant au port une grande pancarte, réclame pour le chocolat Guérin-Boutron, avec l’effigie de Ménélik qui sourit.
Pleine mer, golfe d’Aden. Le port d’Husaydh (Hodeida), est encore loin.
Dans le boutre qui emmène jeeps, gens et bêtes j’entends un militaire parler du voilier d’un Français, arraisonné par les rebelles Houthis. Son embarcation « Eole II est confisquée. On ne sait ce qu’est devenu ce compatriote.
On approche de Sa’Dah, le port Yéménite.
Le ciel est en feu. D’énormes fumées noires barrent le paysage. Bien avant d’accoster on constate que le parc d’attractions proche, Al Ahlam n’est plus qu’une ruine. Plus d’attraction, les dauphins charmeurs sont tués, dépecés. Désolation.
À l’arrivé les houtis, armés jusqu’aux dents, font le tri. Ils sont fébriles, nerveux, le doigt sur la gâchette. Je présente mon passeport, le pass du groupe Marill, le laisser-passer de l’ambassade, de Abd Rabbo Mansour, qui connaît tout le monde ici, civils, militaires, étrangers, « Je leur donne de l’argent » sois genreux «. Profession déclarée : archéologue pour l’Unesco., titre recommandé par mon entourage à Djibout’. Ça marche, on passe, c’est la bonne file. Pour les autres, la mauvaise file, ils sont emmenés en ville, sous bonne escorte.
On stationne au Royal Regency Hotel, miraculeusement épargné, rempli d’uniformes, d’officiels. Dans Hinoma street des files de gens en détresse, cherchant un parent, un ami.
Certains ont des pansements, des tulles entourant la tête pour éponger le sang,
Les mères, hébétées, se tiennent la main, se sauvant. Leurs enfants leur échappent. On les retrouve, plus tard, la tête en moins.
« On devait avoir des nouvelles au Wala tourist resort, quartier général des observateurs, mais la Wala a brûlé. C’est un désastre, l’horreur, l’enfer sur terre. La famine le dispute à la mort. Pas de médicaments, pas d’essence. On ne sait rien. Nous sommes abandonnés.
« Et pas une main amie ? » A.R.
Hodeida est rouge, rouge d’incendie, rouge de sang.
Hodeida est noire, noire des fumées qui montent au ciel. Le ciel existe-t-il encore ?
Où sont les maisons ottomanes aux balcons historiques, aux moucharabiehs qui faisaient la beauté de la ville.
Hodeidah, quatrième ville du Yémen, la porte pour le commerce du café, l’arrivée des pistes, les chameaux, les bazars.
On souhaite, parfois, que les prédateurs, ces guerriers fous, égorgeurs, ceux qui laissent leurs avions semer la mort (civils, hommes, femmes, enfants) connaissent, à leur tour, l’enfer, et, surtout, qu’ils y restent.
Une concession automobile, vitres brisées, bureaux éventrés, laisse, intacte, une pancarte :
« Bros KYA Yémen Director Ahmed Baded.
Nous ne sommes pas les seuls mais nous sommes les meilleurs ».
Se soucier de la pension où Trébuchet soigna Rimbaud ? Ravagée.
Se soucier de la succursale Antonin Besse ? Rasée.
Pension, oubliée, café, grillé, désert. Les chameaux, affolés, courent sur les pistes encombrées de fuyards. Les bombes tombent au hasard. Apocalypse. »
Dans les hôpitaux dévastés, soufflés, les bébés meurent, faute de couveuse.
On a fermé la porte Bab el Mandeb. On ne passe plus.
Peter O’Born, de l’O.N.G. Care, essaye de sauver ce qui peut être sauvé. Il soigne, serre les dents, pleure en opérant.
Le ciel est en feu.
L’hôtel Walibi n’existe plus.
On nous parque à Slil-Torré, un couvent tenu par des sœurs Allemandes, en dehors de la ville, loin du brasier. Il était prévu de dormir à l’hôtel Judith, consulat Français provisoire, le consul est introuvable. C’est le chaos.
Se souvenir d’Hodeida.
Imaginer Besse choisissant le port d’Hodeida plutôt que celui de Mokha, une ville abandonnée.
Que voyaient les Yéménites de son temps, scrutant le ciel, du temps de la paix ? Évoquer les longues soirées à parler avec les voisins, à se passer les narghilés en se souvenant des jours anciens, des jours heureux.
Dans le couvent des sœurs Allemandes viennent se joindre des missionnaires de la Charité.
Monseigneur Paul Hinde, vicaire apostolique, parle des quatre religieuses assassinées dernièrement. Il essaye de s’entretenir avec Oswald Gracias, le cardinal Indien, qui n’a pas de nouvelles de ses ouailles, à Sanaa, à Hodeida.
Beaucoup de catholiques, sous la pression sociale (les guerriers sont partout, sèment la terreur), se sont convertis à l’Islam. L’église de la Sainte Famille, à l’intérieur des terres, a été brûlée, ses occupants égorgés.
Quelques correspondants de guerre sont sur le terrain. Je peux, ainsi, converser avec
Mélanie Priol, correspondante pour le Monde, Martin Griffith, du New York Herald Tribune, une compatriote.
Les puissances occidentales ? Hodeidah, c’est loin. Sur les ondes internationales on entend plus les O.N.G que les diplomates.
Jean-Sylvestre Mongenier, du courrier international, double casquette, l’Onu et l’Unesco, m’explique ce qui est inextricable à mes yeux :
« Les Houtistes ? C’est une minorité Zaïdiste, dans un chisme. »
On apprend la mort du président Ali Abdallah Saleh, assassiné par ses anciens alliés.
La guerre converge vers le front du sud, chez les sécessionnistes.
Hodeidah ? Son port, ses 600 000 habitants, vont-ils être rayés de la carte ?
De nouveaux belligérants arrivent d’Érythrée, passent par la base d’Assab ou par la plaine côtière de Thama.
La route de Sanaa est coupée. Les seigneurs de la guerre du parti Islah pavoisent, passant en trombe avec leur jeep surmonté d’un drapeau ensanglanté. On a l’impression que les animaux, la nature, la terre, miment la douleur, accompagnant les mourants.
Parlez-moi des Irano-Chiite, des pays arabes sunnites. Dérisoire prédominance face à la cruauté, au nihilisme.
La guerre entrave la libre circulation sur la route de Suez. Bab el Mandeb s’est refermé, comme une coquille, bloquant le passage. On ne passe plus.
Où es-tu, l’Intello ?
Un message, un message, enfin : tu es sain et sauf, réfugié, quelque part en Égypte.
J’allais partir d’Hodeida, avec des images de fin du monde. Que Rimbaud, Trébuchet, Besse étaient loin ! Dérisoires, si dérisoires.
On reprend la jeep. Mes gardes et chauffeur m’accompagnent au sud d’Hodeida. Un ponton provisoire d’une O.N.G. des Nations Unies, ponton bien branlant, permet de reprendre le bateau.
J’ai vu les victimes, les innocents. J’ai vu le mal, les guerriers, les puissants dans l’ombre, les sous-fifres, décervelés – tous à mettre au banc de la société. Chauffés à blanc.
Nous vivions la saison en enfer depuis le bateau, hypnotisés, incapable de dire un mot.
Les blanches nations en joie se faisaient dépuceler, en cadence, par un idiot qui parlait du bruit et de la fureur.
Peut-être allait-on annoncer l’Éternité à la prochaine station ?
Sur le bateau je me hissais au-dessus du bastingage et j’y dégueulais tout mon soûl.
J’avais mal à l’humanité.
Repensais-tu à tes découvertes à la bibliothèque de Sanaa, sur les traces des frères Bardey.
Un certain Coppitrotti, correspondant d’Alfred Bardey, auteur de « Le Yémen dansant sur les têtes de serpent », évoquait un certain Besse. Il avait édité une carte « de Sanaa à Hodeida ».
On avait écumé, j’avais écumé, pour toi, de Carnegie à Sanaa en passant par Alexandrie. Le robinet des réponses était tiède. Peu de choses. Et qui était Hilda Florence Crowter, la deuxième femme de Besse, si riche, si près de lui.
Il me faudrait me rabattre sur les relations entre Besse et Bardey, les frères.
Je songeai à me rapprocher de Merril Lynch, mon copain cuistot -chef au restaurant du prestigieux British Museum. Il connaissait tout le monde, les clients des cercles financiers, cercles politiques, cercles littéraires, de Londres, New York. Moi, après avoir rendu, je me rendais. J’avais l’impression de faire du sur place sur un bateau fou qui prenait l’eau.
Revenu, sonné, à Djibouti, je passais toute la journée à me promener dans la ville, à musarder dans les rues pour enlever la boue de mon cerveau, les visions horribles entrevues, devinées, éprouvées, à Hodeida.
Je m’attablais aux terrasses, entrais dans la vieille boutique « Au chic Parisien », rue de Paris, parlais à des touristes de rencontre qui quémandaient leur chemin.
Je m’aventurais jusqu’à la plage de Doralé, sans sortir de la ville.
Mes pas me conduisent au plateau du serpent. Je passe devant les ambassades.
J’approche un café, un peu à l’écart, et je me fais héler, en Français. « Vous ne me reconnaissez pas ? Vous avez mangé chez mes cousins, Pierrot et Annette, au restaurant du Roi Johanès », entre la place Ménélik et le palmier en zinc. Nous avions échangé quelques mots ».
Il me fait entrer, m’offre un café.
« Mes cousins se plaisent bien à Djibout’ mais ils doivent retourner en métropole, dans leur Bretagne natale pour y régler des affaires. Ils vont mettre leur resto en gérance le temps de leur absence, disons pour une paire de mois, peut-être plus.
Il se tut.
Allait-il me proposer le poste ?
Il sortit chasser les chiens errants, éloigner les chèvres envahissantes.
Danielo, c’était son nom, me commenta les évènements, la Corne de l’Afrique qui s’usait en de stériles combats. « Pas bon pour les affaires, tout ça ».
C’était un homme dans la force de l’âge, vif, au parler caressant comme des vagues.
Il me raconta sa vie. Divorcé d’une « pute », comme il disait, une avaleuse de fortune qui ne recrachait rien. Marie-Edmée, la pute, l’avait fait cocu, longuement, avec application. Au dénouement de l’affaire elle s’était mise en ménage avec un Légionnaire. Ils avaient quitté tout deux l’Afrique pour rejoindre la base de la Légion, en Corse, y tenir un lucratif claque à soldats.
Puis, tout à coup : « Vous êtes associé avec les Marill ? C’est vous le mécano qu’il recherchait pour dépanner les grosses cylindrées ?
Ils doivent vous avoir à la bonne car ce sont des gens méfiants, tracassiers. Mais obligeants, ajouta-t-il après un silence, comme pour se racheter.
Mon esprit battait la campagne. Au petit port de Doralé quelques pêcheurs m’avaient proposé leur pêche. Les poissons écarlates, rubis, m’offraient leur regard vide, la gueule ouverte.
Est-ce que je mourrais le regard vide, la gueule ouverte ?
Dans le café de Danielo je me détendais, allongeant les pieds sur les fauteuils de rotin.
« N’oubliez pas qui vous êtes, ne vous dispersez pas, pensez à ce que vous faites. »
Le petit vélo, dans ma tête, j’allais, pour conjurer le sort, le faire rouler à l’envers, vous expliquer :
Écoutez mon double, ma copie, mon alter égo, celui que j’aurais pu être :
Moi, c’est vrai, je ne m’intéresse pas du tout à la littérature. Salarié chez Legrand-Thouars, au port de Djibouti, j’y ai débuté comme docker puis, après une solide formation, je suis embauché, comme électricien-monteur, pour les Messageries Maritimes sur les navires de croisière touchant au port. Je gagne bien ma vie. Je fais ma pelote avant de rentrer en France, où j’envisage de fonder une famille. (On entendait Rimbaud… ».avec un fils que j’élèverai comme ingénieur »…).
Qui parle ?
« Vous êtes sonné par le voyage à Hodeida, la chaleur de ces pays vous tanne. Vous n’obtenez pas de réponses à vos questions. La vie vous semble mouvante, très mouvante.
Mais…continuez. Écrire des pages, beaucoup de pages, noirci le papier. C’est un travail, ce n’est pas le vôtre.
Il continuait :
« J’ai des nouvelles pour vous. Vous ne me connaissez pas. Beaucoup de gens vous scrutent, vous suivent, mais ne mentionnent pas votre nom dans les dîners en ville ».
Vous rappelez-vous de l’imprimeur Bacquenois, à Reims ? Vous rappelez-vous de la maison
Le Palais, à côté ? Savez-vous qu’un parent Marill en était le propriétaire ?
Continuez. Je vous écrirai, de nouveau, de temps en temps «. Avancez.»
Qui me prenait pour mon cousin ?
J’étais bien avancé, encore une fois.
Je repassais à l’hôtel me changer, répondant à l’invitation de Jerry et Tommy.
Toujours beaucoup de monde chez eux, dans les garages, les bureaux (même très tard le soir), les appartements privés.
Nous étions une douzaine à table. Un peu de réticence à parler de mon ressenti, de mes recherches, mon boulot de tour-operator de la mécanique mâtiné d’homme d’affaires à l’essai, à des gens qui m’étaient étrangers.
Les brothers m’accueillir, « tu te mets où tu veux », ne me présentant pas les autres convives, habillés, pour la plupart, en croque-morts de luxe adaptés au climat : vêtements de lin, riches étoffes Indiennes, costars sur mesures de Bond Street pour agioteurs internationaux. Un nœud pap’ de couleur, de ci de là, venaient égayer les matières sombres, les peaux hâlées, les visages basanés. Un ou deux, décontractés, en shorts, montraient des faces burinées, des chemises ouvertes sur des torses velus avec une chaîne, la croix d’Allah. Un monde bigarré. Dans l’air saturé – la fraîcheur montait de la terre, enfin délivrée du soleil – les eaux de toilette subtiles des agioteurs le disputaient aux odeurs des virils baroudeurs débraillés.
J’avais l’impression d’une réunion avec Al Capone. On imaginait les serveurs en hommes de main, le colt sous la chemise.
Les usages se perdaient. L’absence féminine dédouanait ce laisser aller. Je songeais à Armgart de Mongreid, son élégance décapitée dans ce groupe…
Mama Maïté s’enquérait de ma santé dans un large sourire. « Je sais que vous revenez de l’enfer. Essayer de décompresser ». Elle posait sa main sur la mienne.
Elle ne demandait pas de tes nouvelles.
Quand on eût desservi l’entrée, je commençais à comprendre, dans le brouhaha formé par le bruit des couverts et les vives discussions, que nous étions en présence de représentants de banques, de compagnies d’assurance Européennes, Yéménites, Indiennes.
De temps en temps, l’un des deux frères m’adressait un clin d’œil souligné d’un bref « ça va ? ».
Position du prévenu : aucune page écrite sur Besse, pas d’infos.
Je m’interrogeais sur le type de relations entretenues avec les deux frères retrouvés.
Je me voyais un peu comme un maître de conférences pommadé, un peu candide, un peu à la retourne, un peu à la traîne, en exil au pays des rêves, mais connu des autochtones (à quelle époque ?), avec des mains dans le cambouis, avec une clé de huit, et qui se projetait en zigzag vers des horizons complètement inconnus.
Reims.
Bacquenois, l’imprimeur. Il avait une rue à lui, près du cirque où passait Buffalo-Bill, près du Palais, où attendaient de jolies dames, un cirque propriété d’un Marill. Un cousin ? Les souvenirs revenaient de si loin ? Le bar « L’Aquarium », dans le parc de la Patte d’oie, à Reims, venait d’être rasé, laissant les frères simplistes du Grand Jeu désorientés.
Tout en mangeant j’élaborais un plan. Jouer la carte Marill, l’histoire, et accrocher le wagon Monfreid. Ainsi j’arriverai à Besse. L’intello serait content. Il empocherait le pognon.
Je m’édulcorais.
Un indien parmi les convives, dans un sari immaculé, boutonné jusqu’au cou, la tête enturbannée d’orange, raconte la dernière réception. Le Ras Makonnen et l’ambassadeur y participent.
Les invités : Jean Bernard, directeur général des colonies, Lavaure, sous-préfet, Rochefort, ingénieur par intérim, le docteur Pauchois, le ras Nagadi Biserati, le Foutaourati Abé-Ahmed Choum, Larivière, ingénieur en chef de la compagnie du chemin de fer, au Harar.
Table d’honneur. Les femmes en robe de soirée, soirée offerte sous l’égide de la compagnie des chemins de fer Ethiopiens.
On fait passer les photos prises de la soirée, en commentant :
Les Italiens en Érythrée, les Français à Djibouti, les Anglais à Aden, personne au Somaliland (pour l’instant). Les commerçants. Le commerce. Ceux qui en ont la bosse.
On évoque les courses de Rimbaud dans un Ogaden inconnu, l’étude des pêcheries par Monfreid, les concessions signées, les accords à venir, et les appétits des Occidentaux dans cette partie de l’Afrique, ce dernier sujet faisant redresser la tête des convives, la convoitise comme une érection.
On sortait les cigares et les liqueurs. Quelques -uns s’enquéraient des horaires des trains et des bateaux.
Les invités des Marill se congratulaient, s’embrassaient, une main sur le cœur, un œil sur les contrats à venir. De Salamalecs aux vœux rituels « porte-toi bien, que le mauvais œil s’éloigne de toi », la petite assemblée se dissout.
Jerry et Tommy retiennent l’Indien en sari jusqu’au cou, le font asseoir, lui parlent à voix basse. On sort des cartes d’état-major, des cartes de visite, des documents. Le visage de l’Indien est imperturbable mais son regard acéré ; il se tient droit sur son fauteuil de moleskine.
Jerry est volubile, les pieds sur la table, à se gratter l’entre-jambes sans façons, façons désavouées par le regard de l’indien jusqu’au cou. Tommy écoute attentivement tout en alignant des chiffres, griffonnant des notes, puis, me dit, en aparté : « Mais il est tard, monsieur, et nous voilà, ce soir ». On n’en a pas fini avec l’enturbanné (le sari).
Tu as besoin de repos. On se voit demain matin au p’tit dèj. Et, croix de bois, croix de fer, on s’occupe de toi toute la journée, tu raconteras Hodeida, et tout le reste. T’es bien, au moins, à l’hôtel ? Notre proposition de t’héberger tiens toujours, tu sais, mais on respecte ton choix, ta tranquillité, OK ?
Puis, au moment de se séparer : « les filles de Djibouti, t’as fait connaissance ? Les français disent qu’elles ont un goût de vanille ».
Bonne nuit.
Six heures du mat’ dans la salle à manger des Marill. Les invités d’hier soir se sont évanouis.
Six heures, la bonne heure pour se voir, dispos, reposés.
Mama Maïté est là, discrète, tout sourire, s’occupant du service du premier repas de la journée. Dehors, quelques femmes balaient la cour avec des balais de fagot, soulevant des tonnes de poussière.
« Alors, raconte Hodeida, embouchent les deux frères, pour une fois sérieux, les mains serrées sur un café brûlant, silencieux, me scrutant.
Je raconte les flammes, les femmes, les enfants, sur les routes, les hommes qui ne savent pas quoi faire, les vieux implorant Allah, ultime secours, les cadavres partout, les hôpitaux servant de morgues, les médecins qui opèrent sans secours, sans matériel, sans médicaments, les yeux brouillés de larmes, parmi les cris d’enfants.
Un mot, un demi-mot, sur Besse, Rimbaud § Trébuchet. Dérisoire, si dérisoire. Sur mon cousin.
Et puis le ponton inespéré pour reprendre le bateau, sauvé. Sauvé ?
Tommy pend la parole :
« Nous avons un ami, Serge Jaquemart, à Hodeida, envoyé pour y créer une succursale du groupe Marill, un nouveau projet sur la création de bacs maritimes, de sociétés de déménageurs, etc…C’était juste une étude, un préalable. Nous n’avons aucune nouvelle de lui depuis deux mois, malgré nos appels et nos relais sur place. On dit qu’il aurait trouvé une planque chez les sœurs du Saint Sacrement, un monastère un peu plus bas, à dix kilomètres du brasier.
Je racontais les sœurs, l’évêque, les bâtiments. J’avais noté, sur un calepin, les positions géographiques, des noms, des tracés, des coordonnées d’actions humanitaires, des ONG françaises, Américaines.
Je levai vers eux un regard dubitatif. Leur donner un espoir, retrouver ce Serge Jacquemart ? Je ne parlais pas des cadavres vus, les sœurs violées, éventrées, égorgées.
« Serge, c’est un costaud, un débrouillard. Il parle trois langues et a toujours de la caillasse, des billets pour allumer les contacts.
Alors ?,
Alors, on ne sait pas. »
Leur espoir avait la teneur d’un minuscule bout de ciel clair dans un brouillard de décembre, avec un pâle petit soleil, un sale petit soleil.
« Merci l’ami. Et merci aussi pour ta virée dans le sud du territoire. On a repris contact avec les garagistes. Ça nous a aidés et, « Monsieur clé de huit », vous n’avez pas perdu la main.
Ils se détendaient maintenant, passant à autre chose.
Je regardais Jerry tremper ses croissants. Les meilleurs de Djibout’. La boulangerie française livrait le gouverneur, les hôtels, et quelques particuliers.
Le voyage aux Indes, ils me le racontent « Ça s’est bien passé ». Laconiques.
La soirée d’hier soir pour parler affaires. « C’est en bonne voie. Nous avons les bons interlocuteurs ». Point barre. Pas causant sur les affaires. Leurs affaires.
Mais voilà, ils continuaient. Écoutons :
« T’as bien conscience que nous vivons des moments particuliers. La Corne de l’Afrique, point primordial pour la géopolitique de ces messieurs et de leurs intérêts, de tout temps : le Canal de Suez (on passe ou pas), Djibouti, un territoire marqué par la présence Française, hier, aujourd’hui, avec ou sans les nouveaux arrivants, les éminents membres de l’empire du milieu, enfin Aden, le Gibraltar de l’Afrique. Et je ne parle pas de la Somaliland, ce pays qui n’existe pas.
Pour ton bouquin sur Besse, une précision, une proposition :
Une précision : Marill, le groupe Marill, cinq cents employés, productions diversifiées.
Un concurrent : Antonin Besse, son empire, ses employés, ses entreprises qu’il peut monnayer, son histoire, sa réputation, on peut ajouter : sa chance, lucky man.
Il peut, il veut, nous bouffer.
Son talon d’Achille : ses entreprises sont implantées dans le monde entier mais il ne délègue pas.
Il commence à prendre de la bouteille le roi d’Aden. Il est seul, il n’est pas sûr que ses enfants reprennent l’affaire. Enfin, il travaille à l’ancienne, refusant les nouvelles technologies, la modernité. Il n’est pas entouré de spécialistes. Le temps passe. Vulnérable, malgré les succès. Cela commence à se savoir. Tout le monde se connaît sur le confetti de Djibouti.
Nous, nous avons pris les devants, ouvert une école d’ingénieurs maisons, mis sur orbites des juristes, avocats avec le label Groupe Marill. Nos cadres, nos techniciens, parlent Français, Anglais et l’Arabe courant. Ils ont tous les permis pour conduire n’importe quel engin. Tous polyvalents : mécanos et comptables. Et très bien payés.
Enfin Jerry et moi nous sommes frangins et associés, présidents de sociétés, comités, associations, membres des chambres de commerce et chambre consulaire, et, accessoirement, mécènes. Nos vie familiales, nos vies professionnelles, sont bien remplies et ça baigne. La relève est assurée et (tournant la tête vers son frère), la relève est assurée, oui, on s’entend bien tous les deux, même si mon associé a un caractère de chien. De chien fou, ajouta-t-il.
On a la quarantaine, on est en forme, on carbure aux projets, optimisme et ambitions. Voilà, tu sais tout. »
Tommy en avait terminé, mais non pas Jerry : « Et on baise à couilles rabattues, et on se fait des couilles en or, on les a bien accrochées, va, et on fait la fête, on profite de la vie, bon Dieu, avant que le cagnard ne nous tombe sur la tête ! La camarde on l’encule ! Vive la vie, vive l’Amour ! ».
Qu’en termes succincts, élégants, mais explicites, ces choses-là étaient dites !
C’était Jerry, l’éternel, jovial adolescent qui s’entruchait ***, présentement, avec ses croissants. ***s’entrucher : terme Champenois : tousser avec un aliment qui ne passe pas dans la gorge NDLR.
Voilà, Young – Frenchie, reprenait Tommy. Tu sais tout. On en a discuté hier soir, tous les deux, sur ce que l’on pouvait te dire sur notre vie à Djibout’, pour éclairer ta lanterne.
(Et sur ce que qu’il ne pouvait pas me dire : ça restait dans l’ombre ?…)
Pour ton bouquin sur Besse, pour ton cousin, on a une proposition :
On va ouvrir les agendas.
Un peu de temps.
On te proposera de te faire rencontrer un personnage, un fouineur, ce serait un coup de main, une aide dans tes recherches. Il dira oui, car il nous doit beaucoup.
De Paul, notre vénéré ancêtre, fondateur de la dynastie Marill, en passant par Pino « Le Saint Eloi de Djibouti » et Monfreid, leur pirate serré aux affaires, tu devrais trouver quelques strates sur le Roi d’Aden et écrire ton bouquin.
L’inaction me ramollissait. Faire le lézard, déjeuner sur le pouce, le midi, dîner chez les Brothers, et revenir, très tard, me lover dans des amours de hasard.
L’hospitalité des Marill me semblait sincère. Chez eux beaucoup de têtes, dans les bureaux, dans les garages, où je vadrouillais avant de passer à table, parlant aux commerciaux, aux mécanos, baguenaudant parmi les derniers monstres rentrés. J’essayais le dernier modèle de chez Nissan, juste arrivé.
Il y avait, aussi, un transfert, la Land Rover Discovery, la Nissan Qashqai, la Renault Kadjar, la Toyota Land Cruiser, et la vedette du jour, la jeep Wrangler avec essieux Dana 4 X 4, avec plaques de métal de protection sous le véhicule, des pneus Knobry, un treuil Mopar. C’était la voiture du baroudeur officiel de la Corne de l’Afrique ! Taillé pour l’aventure.
À table on parlait métier, importations, prochaines exportations, des commandes, des ventes et de leur préparation. Et des rich customers. Very rich !
On parlait technique, mécanique, de la Mercédès classe G (comme le point G ? Je l’essayerais bien, s’esclaffait Jerry).
La Nissan Navarra avait leur préférence (double cabine et couvre benne avec arceaux).
« Avant qu’on ne s’étale sur l’application Waze, Androïd auto, apple Carplay R-Link 2, on voudrait que tu jettes un œil sur ce dernier modèle vendu. Le client se plaint que le moteur ne monte pas à plus de 2000 tours minutes, qu’ensuite il y a un claquement et de la fumée noire sort du pot d’échappement. On ne sait pas si ça vient du capteur, de la durite fendue et de son tuyau de caoutchouc. Il y a une prise d’air avec le débitmètre. Enfin, ça clignote pas mal sur les voyants. Un avis ?
On allait au garage, on revenait pour le café. Ils me parlaient de projets de création et ventes de fosses pour automobiles, avec couvertures et protection, et puis d’élévateurs mais les contraintes et contrôles divers les laissaient perplexes. Le représentant de la maison Dalis, pour ce projet, devait passer prochainement.
La maison Dalis était spécialisée pour ce genre d’équipement, Aîr, Alu, Basic, Moduco., avec couvercles de protection, et cherchait à se diversifier, à s’étendre, à prospecter. Gamme de fosses de visite, de réparation, ponts élévateurs, levage des véhicules. 1,40 x 1,60 avec trappe et escalier de sécurité, niche. Il fallait penser, également, à la signalétique, accès et sortie, prise d’air comprimé, chasse-roue, ouverture de système de couverture. Et formation des employés.
Nous étions loin de la littérature.
Les Marill allaient de l’avant. Ils voulaient être dépositaire officiel, licence unique, des fosses et élévateurs pour les garages et concessions de Djibouti, de toute la corne de l’Afrique, Proche et Moyen-Orient.
Et ils s’occupaient, également, de déménagements, de bacs d’amarrages, assurances, co-voyages et voyages au loin, containers de pétrole, commerces d’un tas de choses partant pour la France, le port du Havre.
Besse n’aurait pas le gâteau.
Enfin Tommy me proposa de rencontrer Paul Kenny, dit la Fouine, débiteur auprès des Marill, et, paradoxalement, directeur de la bibliothèque de Djibouti.
« Mais, avant, il faut que je passe à la chambre de commerce pour l’organisation de la foire de Djibouti qui se tient en décembre. Accompagne-moi.
Tout en allant, il me parla de la Fouine, pittoresque personnage, directeur et débiteur.
Paul Kenny, né à Londres, habitant Leicester square, était journaliste au Daily Telegraph. Flamboyant, ardent. Un jour, son collègue couvrant les différents Orients, Joyce Lindsay, l’appela pour venir travailler avec lui pour « voir du pays et se faire de la thune ».
Il partit. Il vit du pays mais ne se fit pas la thune escomptée. Je te parle de ça….ça se passait entre les deux guerres, du temps où mon aïeul, Paul Marill s’occupait des pêcheries de Monfreid dans les îles Fersan que ce dernier voulait….françaises ! Il l’aida, également, pour la construction de son boutre l’Altaïr.
Alors, doucement, Kenny loucha vers d’autres possibilités de devenir rentier, avec l’aide de son comparse Lindsay, personnage, on le découvrira, peu recommandable, qui trafiquait, déjà, avec les cigarettes (les gitanes menthol), les whiskies (Amer Dundee, moins cher que le Johnny Walker et plus facile à importer). Trafics à grande échelle. Il inondait, il aurait pu faire concurrence à Monfreid mais notre flibustier s’intéressait plutôt aux différentes drogues, dures, douces, haschich, dérivé de pavot, et à entretenir des relations avec…. »
Il s’arrêta.
« Bref, notre Fouine s’enlisa, doucement, dans des choses malpropres.
Mon grand-père l’avait employé comme…
Il s’arrêta.
Il reprit « mais il connaissait beaucoup de monde, à la chambre des Communes, au stock Exchange, à Londres et…
Il s’arrêta de nouveau…..
Et sur ce qu’ils ne pouvaient pas me dire ça restait (ça resterait) dans l’ombre ? ……
Tommy me dit que tout ça c’était de vieilles lunes mais que la Fouine allait m’aider. C’est ce que tu veux, non ?
Je levai les yeux.
Où sont les contrats, les alliances, les dettes d’honneur, les messages codés, les diplômes fabriqués, le papier timbré, les tours de passe-passe, les coups-bas, les courriers compromettants à en-tête des ministères, des ambassades ?
Réponse : Ils sont dans les coffres des notaires, des banquiers, des avocats.
Les voyous, patrons-voyous, et aventuriers de tout acabit, ont noté sur un petit calepin les dates des prescriptions, et attendent.
Certains, horribles, pas vus, pas pris, continuent de se répandre dans les mondanités, à parler du quatre quarante, des finances internationales, habillés, avec la légion d’honneur comme une tâche sur leur smoking ; d’autres sont happés, pourvoyeurs de contrat sur votre tête, pour l’argent. Ceux-là fréquentent les arrières salles des cafés, ou l’on joue gros, où l’on boit sec, vêtus d’un short et d’une chemise crasseuse, et puants.
On arrivait à la chambre de commerce de Djibouti, place Lagarde.
Créée en 1907 par un groupe de commerçants, la chambre est constituée de quarante-quatre membres élus, tous bénévoles.
Le président en est Youssouf Moussa Dawaleh, la cinquantaine svelte, habillé à la dernière mode Européenne, des téléphones portables plein les poches. Il développe l’I.G.A.D., Businness forum Comesa, avec les soutiens de la World Bank. Il est aussi président de conseils d’administrations, agence française de développement, chambre consulaire africaine et francophone.
Il possédait une collection originale, celle des tickets de présence, jetons de présence depuis la création de la chambre ; la numismatique l’intéressait aussi. Il possédait des pièces rares, comme un coupon de 0,05 francs de 1919 marqué « remboursement au porteur. » Également une médaille- jeton de présence 1921 C. Mes. Au revers de la médaille une antilope, gravée par un certain Thévenin. Un billet, aussi, de 1931, billet de cent francs, Banque de l’Indochine, signé par Marcel Borduge, président, et Paul Bauduin, secrétaire. Tout un fatras de métal et de papier que les héritiers, à votre mort, déménagent, veulent négocier puis, las, fourguent à la benne. Les belles collections finissent dans les poubelles.
« Les histoires d’amour finissent mal, en général, dit la chanson ».
Le président Dawaleh avait créé une loterie « Venez nous rendre visite. Un téléphone Djibouti Telecom Marill à gagner ».
Nous arrivons à la chambre de commerce – j’allais dire : au Palais.
Cette chambre est posée au beau milieu de la place, carré rose et brun comme un Haribo.
Je note la Jaguar 3.81 Mk2 garée juste devant l’entrée.
« Sa trottinette » me glisse Tommy, avec un sourire entendu.
Nous sommes reçus immédiatement.
« M. Marill, comment vous porte-vous, », avec un sourire de crocodile. Tom me présente vaguement comme un collaborateur qui s’intéresse à l’histoire.
« T’as raison, n’en dit pas plus ».
À son long regard silencieux il suppose que je m’intéresse à Djibouti, à l’histoire, à la politique ? À l’affaire du magistrat retrouvé mort ?
Son regard perçant – bien qu’éclairé par un sourire bénin (vous savez, il y a mille manières de sourire), me fait penser à celui de Antonin Besse et de ses juristes. Tout cela est furtif, calibré, joué. Jouons. À quoi ?
L’homme à la jaguar lance un regard à Marill. « M. Dawaleh, cher ami, vous pouvez parler devant Monsieur, il est de la famille, avec un sourire rassurant.
Dans la famille Marill je veux….
Le président -collectionneur nous fait asseoir à un bureau original, fait d’un plan de baobab d’un seul tenant, sur lequel trône, unique accessoire, une maquette du Concorde sur pied. Dans un coin de ce bureau Mussolinien, immense, pas de meuble, on fait cinquante mètres pour arriver au président. Dans un coin des grands drapeaux pour les défilés, Djibouti, la France, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite. Manquent les drapeaux Yéménite et Erythréen. Ils sont, peut-être, au lavage.
Une secrétaire nous apporte, sur un plateau aux armes de la République de Djibouti, de l’eau « Sources du Mont Mabla » Fanta, Coca glacé, thé glacé, avec des mignardises.
Les Arabes ne boivent pas d’alcool, et puis, il fait si chaud, malgré les ventilos. « La clim’est en panne s’excuse le représentant de la chambre.
Dawaleh et Marill s’entretiennent de l’organisation de la foire de Djibouti. On cherche un graphiste patenté, pour la communication.
« Je connais un petit publiciste, Souleiman Abdi Talan. Son agence, fondée en 1998 est à Balbala. Il fait du bon travail, il tient les temps et tient les devis. Petite équipe, mais fiable. Il a emporté le marché pour la présentation du dernier festival de Carthage, parrainée par Claudia Cardinale et, par ricochet, celui de Marrakech.
« Vous savez que j’étais très (sa voix, hésitante, traînait) ami, avec Claudia, quand elle habitait Tunis, dans le quartier de la Marsa. Quelle belle femme. »
Des silences et des souvenirs s’effilochaient. Un ange Africain passa.
« Bon, revenons à nos affaires. Je crois que l’on va s’occuper de votre protégé. Une bonne raison, tiens, pour donner un coup de pied dans la fourmilière de nos services. Avec les relations-publiques et leurs publicistes ils s’y prennent comme des cornichons.
Bien sûr, on fera un appel d’offres officiel.
En deux coups de crayon Abdi Talan était embauché, les supposés autres candidats, évincés. Hop !
Et l’histoire d’amour, avec Claudia Cardinale, remisée.
Après les salutations d’usage (la main sur le cœur que je prends ton graphies), nous prenons congé de l’homme à la jaguar, jusqu’à la prochaine audition pour Marill.
L’air est léger.
Huit heures du matin, les liquettes sèchent, et les testicules se baladent au frais dans le grimpant thermique de marque Artic). Je pense à New York, à mon pays, en ce mois de novembre, à sa brume, son brouillard, son ciel embarrassé : là-bas, à dix-neuf heures on allume les lumières, le chauffage.
Ici, pas de saison, sauf de juillet à août, l’humidité, quand les corps ruissellent, les ventres disparaissent.
À vingt ans se soucie-t-on des pics de la météo aux affaissements sentimentaux vous menant aux éreintements ? Non. La seule règle : mettre une capote.
Les histoires d’amour….
Je souriais en coin, léger, aux abords de la bibliothèque.
Une journée de légèreté, de liberté, en accord, pour vous aider à avance, un pied après l’autre.
On passe rue des mouches.
De nos jours la rue porte le même nom.
Tommy m’entraîne chez une copine, Leîla Castan, qui tient la galerie L’œil. On entre, la galeriste nous reçoit, tout sourire rentré, mince dans son pantalon blanc, un foulard au cou, un autre pour retenir le flot des cheveux.
L’entrée de la galerie, très vaste, meublée de fauteuils caramel, des rangées se faisant face, est accueillante ; l’entrée oscille entre salle d’attente de dentiste et entrée de cinéma. Pas de luxe ostentatoire, une affiche des chemins de fer Provençaux placardée sur un mur, c’est tout. La galerie se situe au rez-de-chaussée.
Une galerie, des photos exposées, la Corne de l’Afrique, le bout, le cap Gardafui s’haussant du col vers l’Océan Indien, les Indes, en noir et blanc.
Je me rapproche.
Une plaque discrète rappelant que la galerie a été ouverte le…. en présence de Claire Denis, la
Réalisatrice, de Denis Lavant, le comédien.
« Claire est une amie. C’est, également, la marraine de la galerie. »
Je me souviens de cette filmeuse de talent, revenue dans ses pays, Djibouti, la Somalie, où elle était écolière. La Parisienne Césarisée, Léopardisée, Langloilisée, passée par la FEMIS, l’IDHEC, et ses copains volubiles, Denis Lavant, Louis Daquin, Philip Kindred Dick, Jérôme Savary (et son grand magic circus), son travail sur Beau Travail (ou : vendredi soir), et puis sa vedette, Grégoire Colin, toute cette tribu tapageuse auprès de cette réalisatrice qui privilégiait le « non-dit ».
Dans un coin de la galerie, deux Boudahs : Nénette et Boni, souvenirs de tournage.
Notre galeriste, ancienne inspectrice des impôts à Paris (pas longtemps et, fort heureusement, reconvertie, avec succès, dans le monde de l’image), d’origine Belge, cousine éloignée de Jean-Baptiste Godin, avait été directrice des serres royales de Laeken,
Avait commis un livre sur « les rêveurs de terrain », Fourier, les phalanstères, Godin, les Francs-Maçons, les Saint-Simonien, les utopistes éclairés de tout poil. Manquait plus que Prudomme et JJ Rousseau. Une galerie de photos, l’intelligensia Germano- pontaine, près des territoires des Afars, des Issas, des Danakils, des Somalis. Avait-elle rencontré Rimbaud ?
Un saut dans ma mémoire. Je repensais à son arrivée à Paris, jeune Ardennais mal dégrossi, gare de Strasbourg. « Je suis jeune, tendez-moi la main », ne trouvant pas Verlaine et Cros au bout du quai, les manquant.
Et puis, un jour, il me faudrait parler – vous savez comment sont les gens, les aigreurs des lecteurs, les demandes et les silences des comités de lecture -, il me faudrait parler de Nadar, Carjat, et de Charles Cros, sa bande, fumistes, hydropates, ses questionnements, seul, dans sa soupente, sur les inventions, la photo couleur, l’appareil à parler, tout un tas de chose qui font que l’Agagadémie se déplace, un hareng-saur dans le dos.
Il faisait chaud, si chaud, dans cette galerie. Il me fallait me reprendre, canaliser un semblant d’énergie nécessaire pour aborder le bibliothécaire « le débiteur des Marill ».
Pendant tout ce charabia scriptural que je notais, les enfants, eux, continuaient de mourir sous les bombes, au Yémen, en Somalie. Un chouïa de lucidité accosterait aux rivages de la réalité, s’accrochant à ma pauvre tête, mes rêves, mes pensées. Ça se mélangeait.
À quoi pensez-vous ?
Ça n’a pas l’air d’aller ?
Des mots, des petits mots usuels que l’on avalait, bien vite ; avec un goût de pâte d’amandes, pour faire passer.
On laissa Leîla Castan et Claire Denis sur le seuil.
« Eh ! Tommy, au fait, ma bund Baker est prête ? Ramène-là un soir et je te garderai à dîner.
Et ton copain il t’accompagnera. »
Le flot de cheveux tenue par le foulard disparut.
« Une de mes anciennes » m’avoua Tommy. Chic fille. Elle aime bien ça, les hommes, la garce, une gourmande.
Les histoires d’amour….
Le Djibouti news parcouru, tout en marchant, Tommy a l’air préoccupé. Il s ‘arrête pour passer un coup de fil d’une cabine Royal Post. Je le vois s’agiter comme un Italien, les mains en l’air. Ça n’en finissait pas. Il raccroche, repart sur un autre numéro.
Enfin de compte, il m’explique – laborieusement – que, suite à la visite du président amateur de jaguar et de collections une pensée lui était venue, corroborée par les nouvelles du jour, une impatience, une inquiétude, comme une intuition.
« Ca ne te dérange pas si tu te rends seul au rendez-vous de Kenny la Fouine ? Je l’ai prévenu (deuxième coup de fil). J’ai une affaire urgente à régler. Je ne pipai mot. Il ajouta : tu sais, la France est partie. La république-confetti est gouvernée par…..Il s’abstient.
Les banques, l’international et tout le tintouin, ce n’est pas toujours évident. Nous ne sommes plus chez nous « mais les affaires y sont. »
« Oui, oui, que l’on soit en Europe, au-delà des mers, Ici, en Afrique, avec les souvenir des colonies françaises, peu importe, les affaires sont les affaires, n’est-ce pas ? » je ne sus que lui débiter des platitudes. On se quitta. « Au razzia Club, ce soir, c’est convenu. Il y aura des filles celles qui allument les nuits de Djibout’». Il avait retrouvé le sourire.
Les affaires, oui, j’en avais entendu parler.
Parler de Ali Abayarid Moussa, jeune, très jeune (ascension fulgurante), de la banque du commerce et de l’industrie pour la mer Rouge, une filiale de la B.R.E.D., qui aurait trempé dans des affaires de faux loyers, de vrais terrains à vendre aux Salines.
La B.R.E.D., petite banque mais grand directeur, Mohamed Moussa Chehem, avait de grands amis. Les dirigeants, hommes de paille, changeaient souvent d’emploi, déménageaient. On en retrouvait, quelques-uns, dans l’eau du Bab el Mandeb, dans les eaux de l’île du diable, une pierre au cou.
Toujours dans le milieu bancaire un certain Ould Amar Yahya avait été condamné pour délit d’initié. Le plus cocasse est qu’il avait la fonction de président de la COB (commission des opérations en bourse, le gendarme de la bourse). Il s’était enfui au Liban avant de se faire pincer. L’un de ses comparses, moins rapide, avait été retrouvé pendu sous un pont de Londres. La B.R.E.D. fut, il y a quelques années, la banque centrale d Djibouti, concurrençant la Banque d’Indochine, respectable établissement rayonnant sur tout le territoire.
Elle avait un peu trop vanté ses places commerciales, le débit de ses opportunités, de ses slogans « faire un maximum d’argent en un minimum de temps ». Faut pas dire ça aux Africains pour qui la notion de temps n’existe pas, pour qui l’argent gagné est géré par les sages, dans les tribus, toujours prêts à en découdre si ils se sentent floués. Les fiers guerriers des déserts avaient des codes d’honneur, le sens des traditions, ils se sentaient hommes jusqu’aux bout de leurs lances acérées. Mâles blancs, vous passez mais on vous observe.
Pour en finir avec la B.R.E.D. ses errements, ses aventures, la banque préféra plier bagages et transférer tous les fonds au siège, place de Longemalle, Genève. Allez-y, c’est près de la cathédrale Saint Pierre, près de la Maison Royale et de Montchoisy, quartier habité quand j’étais banquier Suisse.
« Ne vous dispersez pas. Rappelez-vous qui vous êtes ».
Qui étais-je ? Connu dans l’inconnu ? Avais-je vécu ces histoires ? Quand ?
Les éditeurs nous servaient de l’étalon-temps et nous poussaient à écrire. J’allais dire : à témoigner.
La B.R.E.D., en Suisse, j’y reviens. Je revois Emmanuel Lemoigne, le directeur, me demandant des nouvelles de mon parcours Africain. La rencontre eût lieu sur les bords du lac de Constance. Il chevauchait un pur-sang à débourrer, fumait un cigare et s’arrêta à ma vue.
Une grande gueule. Pour lui, la B.R.E.D, c’était : l’international, mondialisation jusqu’à la lune, et au-delà, FX, dérivés, cash management, relations bancaires choisies, financements structurés, solution de dettes privées.
Il avait 47 ans et il parlait comme un livre.
Il m’avait invité, en souvenir du bon vieux temps, m’accabla-t-il, avec ses collègues, François Monnier, 51 ans, Franck Nater, 39 ans, dans une auberge choisie pour son cadre, avec vue sur le Léman.
La Corne de l’Afrique ? Ils avaient tordu la Corne, et tout le jus, se faisant un maximum de fric et s’en dégageant avant d’être inquiété par les représentants des Afars, des Issas, des Somalis, et des autres tribus.
Ils me parlèrent, curieusement, tous les trois, de leurs passions, la vénerie, la jouissance de traquer les cerfs, de leurs couper le coup, le sang giclant sur leurs uniformes immaculés.
Une jouissance proche de l’orgasme, me disaient-ils, des pensées accompagnant leur déséquilibres quand ils feraient des femmes (des biches ?), et qu’ils les tringlaient dans des huttes de chasseurs. Au moment de l’orgasme avaient-ils, avaient-elles, les mêmes yeux vitreux, dans le vide, que ceux des cerfs mourant sur leurs coutelas ? J’hésitais à leur vomir dessus, ça n’aurait pas cadré avec le chic de l’auberge.
Gens du même monde, du même club :
« On est entre nous ».
Et :
« Vous êtes avec nous ? ».
Je m’éloignais.
La Fouine m’accueillit sur le seuil de cette maison tout en bois, aux couleurs passées, délavées, sa bibliothèque.
La Fouine, de son vrai nom, Youssef Mercier.
Représentez-vous un petit homme, poilu comme un singe, le dos voûté, avec un regard par en-dessous, ou de côté, des yeux qui n’espèrent pas être aimé.
Chafouin, se frottant les mains énergiquement, il attendait que je parle le premier.
Je me présentais.
« Oui, oui, oui, l’ami des Marill, oui, oui, oui ». Il se balançait, se dandinant.
Vous savez que je suis leur otage. Je connais le nombre d’épées de Damoclès au-dessus de moi.
Il leva les yeux comme si elles allaient apparaître.
Je vais vous faire un petit topo depuis les origines.
Pensez simplement aux documents que l’on trouve dans les coffres des notaires, des banquiers, des assureurs. Tous mes pieds, tous mes poings liés, à cause, à cause d’histoires anciennes, histoires d’espions, de trafics, de morts inexpliquées. Savez-vous la plus rapide manière d’attraper un homme et de l’émasculer ? Vous donnez votre langue au sphinx ?
Où vous croyez-vous ? « ; Il finissait sa péroraison en souriant lentement, découvrant des chicots, des dents pourries, manquantes.
Il sortit deux fauteuils à l’extérieur.
« Installez- vous confortablement. » Vous avez rendez-vous au Razzia Club, ce soir. Je commence. »
Il commence.
Youssef Mercier dit, la Fouine, connaissait des histoires, des vraies, des arrangées, et il savait les raconter.
L’histoire d’Aboubaker Ibrahim l’Afar, de Chehem, et d’Ali Aref, de leurs frères Makki, Mahammad qui s’occupaient du centre de castration à Tadjourah, une fabrique d’eunuques, ablation des organes génitaux, après, plus de procréation possible. Pour eux, c’était normal, une tradition qui venait de la reine Sémiramis, de Babylone. Elle émasculait ses amants après consommation. On pratiquait l’ablation des testicules. La plaie était soignée avec du beurre.
Les eunuques étaient envoyés, ensuite, en Arabie. Ils payaient bien.
L’histoire de Rochet de Hericourt, Charles-Xavier de son prénom. Commerçant, explorateur, consul de Massawa. Fut, pendant un temps, industriel au Caire où il s’occupait de fabrique d’indigo. Séjourna chez les Oromos, au lac Tana. Fit un rapport à la société de géographie et au roi Louis-Philippe. Celui-ci le renvoya en Afrique avec un portrait en pied de son auguste sérénité et un orgue de Barbarie, pour civiliser les sauvages.
Il me parla de Pierre Arnoux, qui voulait faire disparaitre l’esclavage en Afrique. C’est lui qui disparut, assassiné dans le désert Danakil, le jour de son anniversaire.
Et puis, aussi, d’Henri Lambert, un espion au service de la France, chez les Britanniques.
Tué à l’île Moucha, sur ordre de Ali Shermaize, directeur des douanes de Zeila.
« Pas de désordre chez nous. Nous continuons l’esclavage, les eunuques avec, et les fusils et les assassinats pour ceux qui nous troublent ».
Troublant, en effet, le discours de Youssef.
Youssef et les Marill. Qui avait le pas sur l’autre ?
Je repensais, un instant, à Monfreid tuant, de sang-froid, celui qui le gênait dans ses affaires, un guet-apens, un boutre, la nuit.
Les lecteurs du cousin réapparaissaient : « Vous ne parlez pas assez d’Henri Lambert, le fondateur de la côte française des Somalis ».
Oui, c’est vrai, comment oublier, à son initiative, l’arrivée des notables locaux à Paris, venus signer la vente de terrains. La terre contre dix mille thalers.
Quand à Denys de Rivoyre (joli nom), il s’ennuie, et, dans la foulée, colonise Obock. Ça l’occupera un moment. Contrairement à son ami Arnoux il ne mourut pas sous les lances des Afars.
Youssef avait terminé. Ses mains croisées sur son ventre, il attendait.
« Et vous ? » me pointa-t-il.
J’aurais pu, j’aurais dû, évoquer l’attentat à l’Historil, le café de mon copain Alain Roumani.
Quarante morts ! Les évènements se poursuivaient, poursuivaient l’histoire de Djibouti, le confetti de la France. On poursuivait les agitateurs, venus de Tunisie, agents du Magrebh travaillant pour d’obscures officines liées au service secret des Libanais.
Djibouti.
Djab-Outi « l’ogre vaincu » en langage Somali. Ou Gabuti, en langage Dankali, au regard des Gabooti, vanneries plates, plates comme les rives, les plages, les environs de la capitale.
En ce temps-là – 1900 – les maisons de commerce Marseillaises florissaient.
L’Express du Midi, le 13 septembre 1900, relataient les fêtes données, les dîners offerts par les autorités aux commerçants, colons à l’assaut de l’Afrique, militaires et aventuriers, mêlés. Et, cela, aux frais du contribuable.
On parlait, parfois, du soldat Fashoda, un sacrifié, et de Marchand, marchant en Afrique pour sa plus grande gloire, où celle des industriels ou des gouvernements, on ne savait plus très bien. Les échanges d’esclaves, d’eunuques, les trafics de drogues, d’armes, continuaient de plus belle.
Tout le monde sur le pont. Le beurre et l’argent du beurre, et le cul de la fermière.
Sur les cartes détaillées, les routes emmenaient ce monde avide, aspirant à la gloire, à la richesse : de la péninsule Arabique on descendait la mer Rouge, l’Océan Indien, la route des Indes et des épices ; escales à Zanzibar (là-bas il y a à faire), la Réunion, Madagascar.
Et qui se souvient, plus proche de nous, bla, bla, bla, bla, bla, de Gaston Defferre et de Mohamoud Harbi 1921 – 1960 disparu dans un accident d’avion. Je me souviens.
Roulez jeunesse !
Qu’aurai-je pu rajouter ?
Après un très long silence Youssef s’entreprit à entrer dans la bâtisse.
Entrons, je vais vous donner …..
Il s’arrêta, se retourna, à la vue d’un 4 x 4 filant à vive allure.
Entrons, si vous voulez bien…..
(((10 JUILLET 2018 L’Éthiopie et L’Érythrée déclarent ne plus être en guerre après vingt ans de combat. Champagne ! NDLR.))).
Dans la bâtisse – une bibliothèque ? – éventée, éventrée, édentée, c’était un capharnaüm de tous les diables.
Un atelier avec ses couleurs, ses mille objets hétéroclites. Les poules cherchaient leur poussin. Les murs suintant achevaient d’humidifier les derniers livres dépenaillés jouxtant des boîtes éventrées de photos, cartes postales, registres, cartouches.
Une lumière blafarde – ampoules grillées – balayait des monceaux de documents, revues, livres, albums jetés à la diable sur des tables, des guéridons, des chaises, ou à même le sol.
Trois salles traversées, trois salles, même aspect.
Au bout du couloir, Youssef ouvrit une porte basse, une porte dérobée dans un faux mur de fausse bibliothèque, de faux livres. On trouve ces installations dans les films, les romans.
Et l’on entre, surprise ! Dans une vaste pièce claire, baignée de lumière où des plantes grasses gobaient le soleil.
« Voilà, c’est chez moi ».
Interdit, je suivais son regard, quémandant une explication.
« Asseyez-vous, remettez-vous et prenez un siège ». Il m’indiquait un fauteuil club très profond, très accueillant, le genre de siège qui vous enrobe pour discuter sans fin du destin du monde jusqu’au matin, avec des amis choisis, comme l’on dit.
Dans la vaste pièce il faisait bon ; la lumière était suffisante. Rien sur les murs, pas de meuble. Un énorme coffre-fort en fonte avec un éléphant en céramique verte sur la porte, tonnait au milieu de la pièce. Au fond, près de la fenêtre, une petite porte donnait sur un dressing. On apercevait, en encoignure, un bar ; on devinait des toilettes, et un divan.
Sur le bureau de Youssef, design et pureté, un téléphone blanc, un bloc-notes noir, un pot de crayons, de stylos, de feutres, couleurs d’arc-en-ciel.
Sous le sous-verre du bureau, deux reproductions, Vanessa Bell à Charleston 1917, par
Duncan Grant huile sur toile National portrait gallery Londres, souvenir du groupe de Bloomsbury, et La lecture (détail) par Henri Fantin-Latour, Lyon, musée des Beaux-arts.
J’étais chez un intello, un beau bobo du faubourg saint germain, un de ces discoureurs écrivaillant dans les journaux, discutant, ergotant sur la vérité sur le Christ, son dépucelage par Marie-Madeleine ou la virginité de sa mère (celle du Christ), et autres tours de prestidigitateurs.
« Je suis un lettré échoué dans le bout du cul du monde » me dit-il, me regardant dans le blanc des yeux.
Puis : « le temps passe, avançons. Vous pouvez me questionner sur mon existence, les Marill, Monfreid, Besse, les coloniaux et hommes d’affaires de Djibouti, de la Corne, de tous les Orients, du bon Dieu et de ses saints (il marqua une pause)…..j’y répondrai…ou pas.
C’est moi qui tiens la corde, pas vous, mais je vous serai agréable, répondant, peut-être, à leur demande, à la vôtre…..Marill oblige, finit-il, vous comprenez ? » (Avec un sourire de Libanais, onctueux, coriace, commerçant.)
Il s’avança à la fenêtre, jetant un coup d’œil à la rue puis, se tournant vers moi :
« La bibliothèque que vous venez de traverser, n’existe pas, c’est une façade, personne n’y vient.
Je suis dans mon bureau, je fais du renseignement.
Devant mes interrogations :
…Enfin, je donne des renseignements, si vous voulez. J’échange. Narquois, il se défilait et me défiait.
N’oubliez pas que, à défaut d’avenir, j’ai un passé, chargé, et un présent, exploitable.
J’ai connu, je connais, les hommes de pouvoir, les gouvernements, les commerçants, les explorateurs.
Et je parle quatre langues.
Bon, alors, je commence :
Antonin Besse, Henry de Monfreid, Paul Marill. Vous pouvez prendre des notes.
Il s’assit à côté de moi, sur un petit pliant, m’observant :
Antonin Besse est né le 26 juin 1877 à Carcassonne, 12, rue de la République, une modeste demeure aux volets bleus dans une rue étroite.
Ses parents, artisans, étaient originaires de Villemoustaussou et Conques, dans l’Aude.
La famille déménage à Montpellier. Le père décède en 1884, laissant sept enfants (Antonin est le cadet). Il effectue son service militaire puis, le 16 avril 1899 part pour Aden, suivant la vague d’émigration de beaucoup d’enfants de l’Aude, allant chercher fortune dans les pays lointains.
1899 Aden….
Qu’en était-il d’Arthur Rimbaud à cette époque ?
Le poète-explorateur était décédé depuis 8 ans. Cette année 1899, Paterne Berrichon, poète de pacotille, marié à Isabelle, la sœur aînée, aimée « moi, je serai sous la terre et toi tu marcheras dans le soleil » la suivante de Marseille à l’hôpital de la Conception, recueillant ses dernières paroles, ses dernières volontés … ce monsieur publiera les lettres de son beau-frère :
Lettres de Jean-Athur Rimbaud
Égypte Arabie Éthiopie
Avec une introduction et des notes par Paterne Berrichon
Fac-similé d’une lettre de Ménélik à Rimbaud
2e édition
Société du Mercure de France
15, avenue de l’Echaudé-Saint Germain
Paris
Oui, et Monfreid en 1899 ?
Monfreid a dix-neuf ans. Il est encore à Paris, en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Saint Louis.
On avait parlé, aussi, d’Eloi Pinot, l’ami de Paul Marill, le fondateur ?
Oui, en 1899, Eloi Pinot, 54 ans, le créateur du port de Djibouti, est rentré en France depuis trois ans, suite à de mauvaises affaires. Il entretint une volumineuse correspondance avec
Soleillet, Rimbaud, Borelli, Bardey, Chefneux, tous de vieilles connaissances.
« Il serait intéressant de raconter la famille Marill, l’origine, Paul et les autres. Et de creuser, d’évaluer, ces appels, ces aspirations à l’émigration des jeunes Audois rêvant d’aventure.
Monfreid, son père, leurs amis et connaissances, le Roussillon, les Pyrénées et puis ceux qui travaillent la langue d’Oc, les personnages qui traversent votre roman.
Avez-vous retrouvé la pension-refuge d’Armgart, à Port-Vendres et….. »
Son discours s’acheva net, la parole bue par son regard tourné vers la lumière du soleil, au loin. Son regard, ses pensées le menaient très loin, au-delà des années passées, du siècle passé.
Un visionnaire, un carbone du renseignement qui enroulerait ses secrets dans les désirs des autres.
« N’oubliez pas qui vous êtes, et pourquoi vous écrivez » …..
Le temps passait, j’avais oublié mon rendez-vous chez les filles. J’étais fasciné par Youssef. Qui était-il ? Un aventurier, un mage ?
Mais il reprenait son monologue :
« N’oubliez pas qu’Aden était la plaque tournante de la région commerciale. N’oubliez pas la perspective des ports étrangers, les Indes, l’intérieur de l’Arabie.
Hodeida. Raccrochez-vous à cette ville, devenue, de nos jours, ville-martyr. Riès s’y installe en 1876. Il est agent consulaire avant de donner sa place, en 1904, à un certain Isaac Tayer.
Vous devriez contacter Alain Rouaud, le vice-consul, spécialiste de la Cyrénaïque. Il vous apprendrait beaucoup de choses sur les rivalités Tian, Riès, Besse.
Et puis, et puis, il y eut l’affaire Besse/ Monfreid, en 1915, le projet d’un bateau de cent tonnes pour faire du cabotage. Besse avançait l’argent, Monfreid s’occupant de la construction. Le lancement du bateau eut lieu en 1917 mais, très vite, les ennuis s’agrégèrent, les Anglais voulant s’emparer de l’affaire.
Pour votre mémoire dirigez-vous plutôt sur les relations Riès/Monfreid/Besse.
« Les Marill suivront ». Cette dernière phrase suivie d’un geste de la main ouverte, les doigts pliés, dépliés comme si il émiettait un gâteau.
Rappelez-vous des accords Sykes-Picot, la puissance des Anglais.
Riès, vice-consul, dut gérer les évictions, frustrations, réserves, intérêts, des militaires, des colons. Mince affaire ! Il s’était fourré dans le guêpier Yéménite. Relisez les articles de la gazette des Indes, écrites par Stéphan Pichon, alors ministre des affaires étrangères.
C’est édifiant.
En 1919 Besse porta plainte contre Riès, l’accusant de se servir de son titre prestigieux pour obtenir des privilèges et des avantages pour sa maison de commerce, à Hodeida, à Aden.
En 1920 Besse offrit les festivités pour célébrer le cinquantième anniversaire de la création d’Aden, suscitant quelques jalousies.
Vous devriez, également, voir Madame Riès-Delarue, gérante des anciens comptoirs
« Savon § Riès », à Djibouti. Vous avez aperçu le président de la chambre de commerce, je crois ? Bernard-Yves Riès en est l’un des administrateurs.
Il a écrit un curieux opuscule « quand les Français buvaient du café au Yémen ».
Et puis, vous qui vous intéresser à Rimbaud, à la mission catholique (Angelo !) creusez la correspondance Borelli/ Monseigneur Jarosseau (la plaque ….).
J’écrivais, j’écrivais, écoutant la mine d’or. Quelle heure était-il ?
Mon correspondant n’avait plus d’âge, il avait traversé les siècles, me dédouanant de mes pensées, oblitérant le passé, New York, Reims, Alexandrie, Djibouti jusqu’à Socotra et la route des Indes, pour m’échapper, m’évaporer dans l’éther.
« Vous qui êtes Champenois, vous avez du connaître Guigniony, premier patron de Monfreid, la référence de Riès ; un négociant Français dans le commerce du champagne, le champagne Mumm. J’ai eu l’occasion de le goûter à l’ambassade de….Je ne me rappelle pas l’ambassade, ni les circonstances, mais je me souviens du champagne. Comment était l’expression…vous dites, en Français…. ah ! Oui, ce champagne « c’était le petit Jésus, en culotte de velours, qui descend dans la gorge ». Il rit, montrant sa dentition en perdition, un semblant de tranchée. Des chicots, des trous.
Guigniony : sa première femme descendait de la famille Riès, tout se tient » dit-il, en claquant des mains.
Voilà, je vous libère, ça fait beaucoup de papier noirci. Ah ! Je vois que vous prenez en sténo ? Vous prenez tout en sténo ? Discrétion des écritures colorées ? Il vous faut mettre tout cela en ordre, monsieur l’agent des secrets.
Il me sourit, énigmatique.
Nous nous reverrons, pour parler de la factorerie Tian, de la maison Rimbaud, à Aden, et faire la promotion de nos beaux produits que nous exportons, produits évoquant un paysage lointain, des aventures (il devenait lyrique), notre commerce, nos épices : noix de bétel, cinname, cardamone, gingembre, curcuma, gomme arabique.Ca aérera votre texte, ça fera rêver les lecteurs.
Il me faudra, aussi, vous parler des fièvres paludéennes d’Aden, et du Grec Anastase Livierato, d’Alto Joseph, d’Angar, au nord d’Obock, de Léonce Lagarde (en smoking dans le désert), des révoltes des nomades Afars.
L’encyclopédiste se tut, me donna congé, dans un petit salut qui se voulait amical.
« À vendre, les corps, les voix, l’immense opulence inquestionnable, ce qu’on ne vendra jamais. Les vendeurs ne sont pas à bout de solde ! Les voyageurs n’ont pas à rendre leur commission de sitôt ! »
(Arthur Rimbaud « Solde », dans les Illuminécheunes).
Soirée au Club des Marill.
Vous vous souvenez de quoi ?
De disques rouges, bleus, balayant la salle, du bruit de la musique, de filles alpaguées dans la pénombre, en des boxes douteux.
De Djibouti Arabe, de Djibouti Français, de Djibouti Indépendant, je me souviens.
La vérité s’étalait devant moi, entre des bouteilles d’alcools frelatés.
Je pensais au massacre à Hodeida, à Youssef, Youssef de tous les siècles, immortel, éternel.
Je pensai à la vie devant moi.
À l’hôtel je tombais dans un sommeil de plomb.
Je rêvais de Youssef, grand prédicateur, et tous les mages, chercheurs, instructeurs, incrusteurs l’accompagnant dans une longue marche les menant au haut de la montagne, s’arrêtant, explorant le vide.
La fille, « à lèvre orange », avait un goût de mangue.
Au réveil il était midi.
Ma première pensée fut pour Besse, arrivé à Aden, chez Bardey en 1899.
Le contrat de trois ans s’achève en 1902.
1902 : La frontière tracée sur l’empire Ottoman. 1902-1904. Pour ce tracé deux commissions, l’une, Britannique, à Aden, l’autre, Ottomane, au fort Al-Turba. Pendant les pourparlers une série d’accrochages a lieu avec les tribus locales (dix tués, vingt-cinq blessés).
La protection surfe sur les traités, débouche, doucement, insidieusement, vers le protectorat d’Aden. Que regardent les peuples, les tribus, les autochtones ? Bénissent-ils les décideurs, les salueurs de balcon ? Modelages et remodelages, vent dans les crânes.
Le fort Al-Turba ? Il se situe au Yémen, au ras Bar précisément, en face de Bab el Mandeb, de l’île Périm. Une île, Diodore en Grec., faite de lave et d’oubli avec un phare, construit en 1861, une île ou passait, au large, la Compagnie Britannique des Indes Orientales (le nom frise bien la nostalgie). De Périm à Obock passait le câble sous-marin du télégraphe.
Bardey en 1899, Hodeida vers 1902. Besse, que fait-il après ?
Habite-t-il au Crater, Aidrus Road ?
Épouse-t-il Hilda Florence Crowter, une Britannique dont il aura cinq enfants ?
J’allais aux renseignements chez Merryl Lynch qui tenait le restaurant du Benito Muséum.
On y mangeait le pain Grec, beurre fermier de Notherberland, chutney aux prunes, salade des jardins Buretta, aiglefin à la bière, cheddar aux pommes, Roney croupe d’agneau Marsh, tarte au citron. Vous ai-je parlé de Copretti, du « Yémen dansant sur les têtes de serpent » ?
Un méli-mélo bigarré, vous en conviendrez, dansait dans ma tête.
Avec mon bloc-notes de sténo je possédais quoi ?
Savoir qui je suis et ne pas lasser le lecteur.
Je rêvais d’un prix. Lequel ?
Tout cela me semblait dérisoire. Il ne se passait rien. Tout était figé.
L’eau courrait sur les quais de marbre. J’avais un dictionnaire de mots, flambant neuf, dans ma tête.
Ce qui était certain c’était la chronologie d’Antonin. Avant d’épouser Miss Crowter, il avait épousé Marguerite Godefroy, très riche, dont il eut deux enfants.
2 + 5 = sept enfants. Très prolifique !
Il équipe, finance le bond en avant d’Aden, son développement, son commerce, sa communauté. Il escalade les montagnes, monte ses chevaux, nage, créé une usine de savon en 1934, équipe les boutres de moteurs diesel en 1936, créé une usine d’huile de coco en 1937, fait de l’humanitaire, est résistant pendant la guerre, créé une compagnie d’assurances. Quel homme !
Et il rencontre Monfreid…
Monfreid ami des Marill, Aden, Djibouti, la boucle est bouclée pour continuer, étaler le récit.
Monfreid, la bande, les commerçants. Avançons un peu.
1919 Djibouti ? Ce n’est qu’une rade où mouillent, au loin, à l’ancre, les bateaux.
On n’accoste pas, pas assez de fond. Monfreid va participer à construction de la jetée du port. En attendant il installe un chantier à Obock. Ce chantier est à la disposition du gouvernement pour l’entretien des phares et des balises. Monfreid ne reste pas inactif : lance un commerce d’espadrilles de Prades – son pays – puis il s’associe aux Marill.
En 1923 Pierre Marill, le fondateur, a 42 ans. Monfreid juge ce négociant « sous des dehors pragmatiques, relations d’affaires, c’est un être chimérique et timoré. Des deux c’était lui le rêveur, moi, l’homme d’action. » Curieux attelage.
Associé aux aventures et plus. Il rentre, dans cette association, de l’affectif.
Pierre Marill sera le parrain d’Amélie et de Daniel de Monfreid.
Le parrain retrouve Armgart en Allemagne, voyage avec Henri aux îles Farsan, finance les voyages pour le haschich.
Leurs attaches respectives à Port-Vendres les rapprochent.
Armgart, éternelle public-relations, est amie avec la jeune épouse de Pierre Marill (vingt ans de différence), et elle contribuera aux bonnes relations entre les deux hommes.
Bonnes relations….on connaît le côté ombrageux du pirate, l’appréhension qu’il a de toujours se faire avoir.
Et Besse ? Difficile à contourner. Sans doute sait-on que Besse a présenté à Monfreid un capitaine, Ternel, qui lui fut d’une grande aide, puis un énorme frein dans l’imbroglio du vol de haschich qui venait de Bombay, au départ.
La suite ne fut pas reluisante : Ternel intercepte la cargaison de drogue…. Et s’enfuit, Monfreid à ses trousses.
À Djibouti Pierre Marill remuera ciel et terre pour faire arrêter Ternel et sa cargaison volée.
À Massawa, Erythrée, Schouchana, le courtier en pierres, de la bande à Henry, alerte ses « éclaireurs » : Trochanis, Gorgis, Bitounis. Des apprentis repris de justice. Des trafiquants navigants entre des eaux, un canal, une mer, un océan.
Et, pendant ce temps, les choses s’accélèrent, le passé revient comme un boomerang :
Lucie, la mère de Marcel, le fils qu’elle a eu avec Henri, part pour Casablanca.
On envoie le jeune Marcel à Djibouti, via Marseille. Peut-être que Marill va l’embaucher ?
Les deux Français, Monfreid, Marill, ignorent qu’ils sont surveillés par les autorités. Des notes sont envoyées au ministre des colonies. Affaires douteuse, trafics en tous genres, espions (doubles avec les Britannique, les Italiens ?). Le dossier commence à peser.
Et, pendant ce temps, Antonin Besse ? Et mon manuscrit ? Celui de l’Intello ?
Lui avance, je recule.
Finalement, je passe mes journées chez Youssef, recherches, écritures. IL me conseille, me donne des tuyaux, des renseignements, se rétracte, puis continue, dit ce qu’il sait, mais pas tout, et m’abreuve de café brûlant pour tenir le coup (comme votre gros Balzac dans sa tanière de Segré me dit cet érudit, modeste, contemplant sans illusion le genre humain).
Les Marill sont au courant, me laissent tranquilles et me donne leur bénédiction.
« Donne-nous des nouvelles de temps en temps. Tu vas finir les nuits avec lui ? ».
Les nuits je les passe dans mon petit lit d’oie, avec la fille à lèvre orange, le Kâma-Sûtra en bandoulière. Elle m’a adopté, accepté, acclimaté aux circonstances.
La journée elle est employée, serveuse, au club des officiers. Un peu de français, un peu d’Anglais ; une vie indolente mais qui lui convient. Une Mata-Hari en devenir, mais qui n’en n’a pas encore conscience.
Je reprends, je me répète :
Besse : ça cartonne, tout lui réussit, ses entreprises, ses projets les plus fous, mais….
Où l’on parle de Charles Michel-Côte…
Charles Michel Côte 1872 _ 1953
Militaire puis homme d’affaires.
1897 part pour Djibouti, rejoindre la mission Marchand à Fachoda. Très impliqué dans le développement de la banque d’Indochine. Ami de Louis Jacquinet, ministre de l’Outre-mer en 1953.
Président de la compagnie de l’Afrique Orientale CAO.
Président de la compagnie du chemin de fer Ethiopien.
Ennemi intime de Antonin Besse, en affaires, en prépondérance. Qui va manger l’autre ?
Rappelons l’annuaire des entreprises coloniales et puis Victor « le soyeux », encore un Lyonnais, comme les frères Bardey ; à croire que les adeptes de la langue d’Oc et de la vallée du Rhône se sont donnés la main pour aller faire fortune, apporter la civilisation, convertir, coloniser ces pays inconnus.
Besse est considéré – se considère – comme le premier commerçant de la Mer Rouge.
Il s’appuie sur le réseau commercial existant….et sur la Banque Gusarati, de Bombay, pour débuter, puis activer les affaires, récolter les fonds, en complément des banques Françaises et des prêts de sa famille.
Ses réseaux le conduisent aux relais côtiers, Zeila, Berbera, Assab, Massawa.
(Voyez la carte).
Il tente de se rapprocher de la maison Riès, de Djibouti « Savon § Riès ». En attendant il s’implique dans la société « Shell ».
Il est bien dommage que les archives du siège Besse aient disparu, lors des violences d’Aden.
D’autres chercheurs n’ont rien trouvé. Déploration.
Certains voudraient créer et s’impliquer dans la confrérie des chevaliers de la Corne de l’Afrique, comme on s’implique dans la confrérie des chevaliers du taste-vin.
Les insolations dues au Dieu Râ, les vies disloquées par le khât, ont bien lieu, et l’on continue de fréquenter Johnny Walker, un Américain à Djibouti. On a retrouvé Denis Lavant, émacié, fou, beuglant les illuminécheunes dans l’Ogaden meurtrier… mais il n’y a pas d’ambulances dans le désert, elles risqueraient de s’ensabler.
Pour la confrérie voir l’Institut du monde Arabe, la Société de géographie, les Marsouins, anciens de l’infanterie de marine.
Après la deuxième guerre mondiale Michel Côte et Besse s’entre déchirent, pour un peu plus qu’une poignée de cerises. Le Carcassonnais brise les blocus, en appel à Vichy, à Londres, s’entregente avec la mission Appert Palewski.
Encore en 1951 (ils sont tous deux octogénaires !), ils se déchireront pour l’implantation d’Assab, Besse, la coopération avec la banque Worms, Côte.
Ce seront des bâtisseurs d’empire, des Napoléon à la petite semaine, jusqu’à leur cueillette par la camarde, cette grande faucheuse.
Les coffre-forts ne suivent pas les cercueils. NDLR.
De petits messages m’arrivent à l’hôtel, des petits bouts de papier. L’intello ?
Renseignez-vous auprès des anciens comptoirs Riès, 77 rue du Dragon, à Marseille.
Paul, Maurice, Bernard, et les autres Riès, import-export en cuirs, peaux, cafés, ambre, encens, civette.
Et puis, Paul Marill, imprimés, cotonnades, ciment, tôles ondulées, galvanisées, liqueurs, parfums, biscuits, coutellerie, nacres, trocas, écailles de tortues, café. Consultez les livres de commerce.
J’avançais. Les signes cabalistiques de la sténo s’amusaient sur mes carnets noircis.
Youssef était toujours aux commandes, les frères Marill toujours bienveillants.
J’étais complètement libre. Mais pas de nouvelles de mon cousin.
J’espérais, encore, quelques rodomontades de Monfreid, ses amis, les affaires.
Elles arrivaient.
En les attendant, une pause ; traverser la mer Rouge pour Aden, pour y retrouver le restaurant Baad’Err, près du Crater. Là, on y déguste le délicieux mouton mandhi. Le patron, Orion, est un ami. Il a vu passer Bob Morane et combien d’autres aventuriers. Et il possède toute la musique Française, d’Yvette Horner à Indochine, qu’il passe en boucle !
Le soleil jouait sur le corps de ma compagne, enveloppé de sommeil.
Cinq heures du mat’.
S’étirer, se désensommeiller, s’émerveiller de cette journée à venir.
Se sentir jeune, svelte, le corps ne lâchant pas ; prêt à toutes les équipées à venir, à tous les équipages souhaités.
L’Orient, rose orangé, se mirait dans l’avenir.
Monfreid s’installe, avec Rémi Lavigne, à l’île Mascali. Ils vont jouer les Robinson. Le pauvre Lavigne mourra quelques temps plus tard, sur le front de Syrie, mort pour la France.
Henri, lui, emmène sa femme découvrir Obock, le petit paradis, traficote avec Besse (la contrebande de haschich leur rapporte, à chacun, 7000 francs, soit 147000 euros).
Allers-retours Obock-Aden. Henri est hébergé par Besse.
Et, pendant ce temps-là, en France, c’est la guerre, les trouffions, en Champagne, se font descendre comme des lapins au chemin des dames. Bonne du général Nivelle, tu peux refaire le lit du général, mettre des draps propres. Le général va y mourir, de sa belle mort.
Les tués, eux, mourront dans la boue, dans la merde, explosés, en appelant leur mère.
Les Russes, eux, s’occupent de révolution. On est en octobre 1917.Malheur aux souscripteurs d’emprunts Russes. Vous n’avez plus qu’à les encadrer !
Monfreid est arrêté (les motifs sont multiples avec ce genre de personnage). Coups de canon, débarquement à Berbera. Henri se justifie. « Le soir, dans le carré du commandant britannique marié à une française, je suis reçu. On boit du bordeaux, je joue au piano ».
Rodomontades. Et puis, la liberté reconquise….
Monfreid flibustier, aventurier. Mais aussi menuisier, charpentier. Il rencontre un Suisse, près d’Addis-Abeba, qui tient une scierie. L’Helvète lui vend du bois pour son petit chantier naval.
« Monfreid, boutres et toutes constructions. S’adresser à Obock ». Monfreid affrètera quantité de bateaux pour cabotage et pêche de perles aux Iles Farsan, Schouchana en remorque.
Besse « le roi du cuir » rencontrera plusieurs fois Monfreid à Djibouti, à Aden, pour des affaires fructueuses.
À noter : Besse, bon gestionnaire, avait une bonne connaissance des affaires et des hommes. Il apportait l’argent …… mais laissait Monfreid prendre tous les risques. Ça ne vous rappelle rien ?
Arthur Rimbaud, Antonin Besse
Ils ont démarré tous les deux leur carrière à Aden, chez le même patron, Alfred Bardey.
Le premier perd une jambe et ses avoirs.
L’autre finit milliardaire. Il est anobli par la reine d’Angleterre.
Mais lequel est le plus connu de nos jours ?
Rimbaud, l’homme aux semelles de vent : pas un jour qui ne voit son nom dans un article, une émission. Et pourtant : l’œuvre est courte, hermétique, étrange et vertigineuse, fusée à multiples étages. « La vraie vie est ailleurs », « Il faut être absolument moderne ». « Je est un autre ».
À sa mère, la terrible Vitalie, qui monnaye le manuscrit « une saison en enfer » et qui ne comprend rien au texte de son cadet, et qu’elle interroge,
Rimbaud répond : « ça veut dire ce que ça veut dire, et dans tous les sens » ……
Besse, le milliardaire d’Aden : exhumer cet inconnu, l’emmener d’Aden à Oxford, parler de ses compatriotes, Monfreid, Nizan.
Églantin n’a pas de nouvelles de son cousin. Où se balade-t-il ?

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29143982
On a évoqué les soirées de Léonce Lagarde à Djibouti, celles de Henry de Monfreid à Paris, celles d’Antonin Besse à Oxford, tous trois en smoking.
Ils ont franchi les dernières haies, politique, littérature, finances. Une sorte de réussite.
Pour Nizan, c’est en option, avec le reste, tout le reste. Je tiens bon le gouvernail tandis, qu’au loin, évanescentes, les fumées des bateaux disparaissent dans l’éther.
Des nouvelles du Rémois Africain ! Il est à Alexandrie pour un bref séjour, le temps de m’approvisionner en comptes rendus. Il va bien, demande des nouvelles. Une longue lettre devrait suivre. Il va bien. Je suis (un peu), rassuré.
Je reprends.
Donner de la copie à Besse, aux lecteurs.
Monfreid se met à la couture : usinage de boutons avec les trocas, ces coquillages à nacre, s’associant avec Paul Marill, le négociant de Djibouti qui est, déjà, à 40 ans, président de la chambre de commerce. Ils s’adonneront, tous deux, sans état d’âme, au trafic du haschich. Il faut de l’argent pour démarrer ce genre d’activités, aussi Marill s’associe-t-il au pirate pour trouver les 100 000 francs (109 000 euros) nécessaires à l’achat de la cargaison en Inde.
À Djibouti, Lucien, le fils de Lucie Dauvergne, adopté par Henry, voulant rallier Obock à la voile, se noie en mer.
Nous sommes en 1920. Le prix Nobel de la paix est attribué au Français Léon Bourgeois, on avance ….mais loi interdit la contraception et l’avortement, on recule.
Et, en 1921, naissance d’Amélie, à Obock, deuxième fille d’Armgart et d’Henry.
Et, en 1922, naissance, à Djibouti, de Paul-Daniel, dit Daniel, aussitôt circoncis, comme papa.
Marill est parrain et correspondant de Gisèle, la fille aînée, en pension à Djibouti.
Les deux hommes se connaissent bien et Marill est souvent invité à Araoué, près du Harar, où Henry a acheté et aménagé « un autre paradis », pour sa famille.
Cabotage Obock-Massawa avec Marill. Progressivement Monfreid équipe ses boutres de moteur diesel.
En France Gaston Doumergue est président de la république.
En Égypte Zaghloul Pacha forme un gouvernement, à la demande du roi Faoud.
À Djibouti le gouverneur Jules Lauret part sous les huées. Regrettera- t-on Chapon-Baissac ?
1925 Monfreid demande à sa femme d’acheter une maison en France, mais se méfie des bolchevistes. « L’asile de vieillard aux frais de la société communiste ne me dit rien ».
Monfreid est l’ami de Paul Vaillant Couturier, directeur de l’Humanité, mais ami, également, de Benito Mussolini, dictateur patenté. Communisme, fascisme suivant ses intérêts.
Hitler écrit. « Mein Kampf » paraît. La bête immonde sort de l’ombre.
Marill va mal. Au retour d’un voyage Monfreid le retrouve « en voie de gâtisme complet ».
Et madame Marill est malade, atteinte d’emphysème.
Monfreid ne veut plus travailler avec lui. (Mais sera content de le trouver pour payer une amende douanière de 25000 francs (15 000 euros).
Alors, il s’associe à un certain Luciardi. Et puis il y a ses usines. S’en occuper, réparer les moteurs des générateurs électriques, trouver des mécanos. Quelle activité ! Il faut que l’usine de Diré-Daoua reparte. Électricité, pâtes alimentaires, et les trafics, tout lui est bon. Transport des caisses, vente, achats, livraison : 200 kilos de cocaïne, 100 de haschich ; Les affaires marchent.
Il négocie, avec le ras Tafari, futur Haîlé Sélassié, un contrat d’électricité.
1929 Marill va mieux et rappelle à Monfreid que « lui seul a acheté et fait expédier des mitrailleuses sur documents faux et truqués qui ont complètement trompé sa bonne foi.
« Henri, tu as été d’une imprudence insigne qui m’a coûté très cher en argent et en désagréments…. ».
1930 Couronnement d’Haîlié Sélassié empereur d’Éthiopie.
Mauvaises affaires.
Monfreid songe à vendre les Gauguin en sa possession.
Baisse du thaler à 6,15f.
Les Italiens (le Duccé !) en Éthiopie.
Repici, directeur de l’usine de Diré-Dawa est Italien. Les envahisseurs veulent déclarer nul le contrat d’achat d’Henry, le liant à l’usine, et aux autorités Ethiopiennes. Monfreid est écœuré. Et voici que Chapon-Baissac se réveille et veut saisir tous ses biens.
Et le négus s’y met : il veut chasser les Français de son pays.
Et les liens avec Amgart se distendent.
Tout va mal.
Il n’y a plus qu’à prier Allah.
« Enfin, il y a, quand on a faim et soif, quelqu’un qui vous chasse. » AR
1933 Albert Lebrun est président de la République.
Les affaires ne s’arrangent pas. Sous la pression des Italiens, Repici, le gérant des usines de Monfreid à Diré-Dawa, déclare que les usines lui appartiennent. Monfreid est floué. Procès ?
Le négus ne veut pas recevoir Henri.
Hitler est nommé chancelier d’Allemagne.
Henri expulsé d’Éthiopie. Ses articles incendiaires contre le Roi des Rois ont déplu.
Et Marill ?
Il est toujours à Djibouti où il résidera jusqu’à son décès, en 1957.
Durant la 2e guerre mondiale il alimentera, clandestinement, Djibouti en vivres. Il deviendra l’âme du ravitaillement.
George-Daniel de Monfreid exécute le portrait de Paul Marill.
Dans le « soleil de Djibouti », journal local, on lit :
« Cancaneries sur la place Ménélik » :
« Une crapule à Aden : Henry de Monfreid est vu au port d’Aden. On le croyait parti au front !
On le voit en conversation avec Antonin Besse, l’homme d’affaires bien connu.
L’or blanc : il suscite des convoitises. Un commerçant Italien nous parle des salines de Djibouti.
Léonce Lagarde (avec portrait) : une vie au service de la France. Son histoire.
Le thaler : la première monnaie de l’est de l’Afrique. Une amorce vers le Franc Djibouti. »
Je découvre une photo de 1933 du Crater d’Aden, prise de l’avion de Besse. À gauche l’île de Sira, à droite le Main Pass.
Photo « vente de dattes de palmiers doums à Shaykh Uthman. Et puis une publicité pour le savon (son savon, son avion, son hôtel….) savon aux poires (Bath night) et le savon Palmolive avec la réclame : « gardez le teint du jour de votre mariage » ….On parle aussi de glycérol, glycérine, de suppositoires, de lubrifiants. Étonnant.
Enfin, une dernière photo, le port de Mikalla.
C’est une bien maigre récolte. Pas d’autres documents.
La sténo ne court plus au bout des carnets.
Témoigner ? Arranger ? Écrire sur le secret milliardaire, ses deux épouses, ses sept enfants, et l’histoire du don de sa fortune à Oxford et la suite ?
Interviewer Nizan, le précepteur.
Je prends mes cliques, une claque sur les fesses de ma belle dormeuse et au revoir.
(NDLR : vous ne pouvez pas partir comme ça. Il vous faut prévenir les Marill brothers, Eg’, Youssef…..et vos lecteurs. Je vous sens un peu fébrile. Auriez-vous abusé du champagne ? Ou bien, avez-vous retrouvé vos vingt ans.)
Dernières parlottes avec Youssef, toujours terré dans les dédales de sa bibliothèque-cimetière.
Détendu il ne me parut pas surpris de mon départ. « Vous avez appris beaucoup de choses, à Djibouti, au Harar. Mais, le plus important, c’est ce que vous avez appris sur vous-même, n’est-ce pas ? ». Il dit ces derniers mots en relevant la tête, lissant sa barbiche blanche, avec un sourire indéfinissable. Je vous souhaite bonne continuation, vous êtes sur la bonne voie.
Si vous aviez besoin, passer par Marill. J’ai été content de vous rencontrer, portez-vous bien, mon ami ».
Il m’accompagna au bout de la boutique mais, sur le seuil :
« Vous n’avez jamais été mécano comme votre cousin Églantin, ni chez Marill ni ailleurs. Vous avez des doigts de pianiste. Peut-être que le surnom de Clé-de-huit allait à l’un de vos personnages, ou à un homme que vous avez connu…..il y a longtemps. Ou peut-être que vous aviez raison » Je est un autre «. Vous aurez tout le temps d’y penser dans le taxi qui arrive ». Et il leva la main en signe d’au-revoir.
Les Marill : absents. Leurs fiancées de passage, pieds sur les bureaux, à la grande désapprobation de la gouvernance, voulaient organiser une fête pour mon départ. Le départ de l’étrange Français qui évoquait des paroles des écritures.
Les Marill étaient en Italie, partis à l’enterrement de leur fournisseur et ami, Sergio Marchionne, PDG d’Alfa Roméo, Fiat-Chrysler, Ferrari. Mort brusquement à 66 ans. Eg’ les accompagnait. C’est un avis de la Repubblica qui les avait avertis. Ce fils de carabinier, avocat d’affaires, agrégé de philosophie, avait découvert le monde de l’automobile, et s’était élevé, à la force du poignet, et en jouant des coudes, les gros bras. Quant à ses pognes, il les glissait dans des gants de velours « Mazarin », la meilleure marque. Arriviste ? Non, mais il voulait arriver. La finalité n’était connu que de lui seul.
Le défunt était un ami de Besse. Ils avaient, légèrement, tous deux, essayer de trafiquer dans le groupe Lawson, et à la Acklands Limited. Associé au milliardaire d’Aden il avait voulu créer une banque internationale à Zurich et faire une O.P.A. sur les Agnelli mais la famille, des ogres Florentins, apparentés aux familles Médicis, descendants des Machiavel, s’était défendu en attaquant, en combattant pour le faire disparaître, ce qui avait amené Marchionne à perdre, avec fracas, les marges puis la disparition totale des marques Landa et Lancia. On ne s’attaque pas à la famille Agnelli.
Les Marill Brothers se rendaient aux obsèques à Chieti, dans les Abruzzes, à bord de leur jeep Renegade flambante neuve, une sportive de 110 cv, avec une cylindrée de 2300cm3, une boîte de vitesse de 5 à 6 rapports., sièges chauffants, rabattables, des distributeurs, un de chewing-gum, l’autre de préservatifs. Ne pas se tromper sur l’usage.
Donc, tout le monde se connaissait, se tenait, Marchionne, Besse, Marill. En creusant on aurait pu trouver Monfreid en apporteur de fonds.
Dans ce monde d’affaires personne n’aurait parlé à Rimbaud, jugé amateur.
Le cambouis avait disparu de mes doigts. Il restait Eg’…
C’était le temps des au-revoir.
Le taxi brinqueballant m’emmena à la gare de Djibouti. Embouteillage, dus aux manifestations pour la libération d’Ibrahim Hassoum Goumba, le jeune leader de l’’opposition.
« Libérez notre camarade ».
La fatigue, la chaleur, le bercement du taxi m’incitèrent au sommeil.
Je rêvais :
Un mois pour se rendre à Addis : les populations montent avec leurs chèvres, leurs ballots ; les enfants- si beaux – ont des visages mangés par les mouches.
Soudain, changement de décor dans le train : un train en technicolor, technologie sophistiquée, sièges profonds avec, dans l’accoudoir, une fiole de Johnny Walker avec son gobelet.
Un contrôleur Chinois contrôlait. « Passeport, passeport s’il vous plaît ». Je ne le trouvais pas. « Mais, vous savez, ce n’est pas grave, je suis un ami personnel de Mao, votre trublion de président. ». Une volée de bois vert m’atteignit. Il s’était mis à plusieurs pour me tabasser. Que de chinoiserie pour un passeport, un mot pour un autre. Soudain un homme se retourna vers moi tandis que les coups continuaient à pleuvoir. « Vous rappelez-vous de moi ? Daniel Pinson, de la presqu’île du Héron. On s’est parlé. Je vous avais prévenu. Ne revenez jamais. »
Le retour à Djibouti «. Il parlait, plus il parlait plus son corps grandissait, plus celui des Chinois rapetissait. Tout allait très vite maintenant, comme sur les manèges de montagnes russes, chinoises, très vite ».
Je m’éveillais, en sueur. Le taxi était devant la gare et attendait. M’attendait. Les attendait. Les entendait.
« Vous n’avez jamais été mécano ». Ces mots résonnaient dans ma tête comme une enclume de forge. Qui était le mécano ? Cuedo.
Je serrai dans mon portefeuille la photo donnée par Youssef. Une piste ?
César Tian, de profil, cheveux très court, longue barbe grise.
Au verso :
« César Tian installé à Aden, voyageur à Zeila, Berbera et au Harar ; assistance aux voyageurs français visitant Aden et la région voisine.
Photo studio Cayel Frères 40 rue Saint Ferréol, Marseille. Offert par Georges Revoil le
5 aout 1884. »
Revoil, la 9e photo, sur la terrasse de l’Univers.
Tian, le dernier correspondant.
Partis de Djibouti ces fantômes lavés, embarqués sur un méchant rafiot, pensaient rallier Aden. Ils seront arraisonnés par les pirates, dépouillés, jetés aux requins. Qu’importe : bien sûr, les fantômes n’existent pas, n’ont pas de vie propre, ce sont des ectoplasmes.
Je sentais une main sur mon épaule, la main de mon ange gardien.
Il me fallait revenir en arrière, revoir Rimbaud en urgence avant que le mal qui l’affligeait n’avance, que le genou gonfle, enfle. Prévenir Baba, de l’hôpital Peltier, à Djibouti.
« As-tu un lit de libre pour un confrère mal en point. Rimbaud, au Harrar. Il ne veut pas se soigner, une vraie tête de mule, un Ardennais. »
Est-ce le Rimbaud des Messageries Maritimes ? Je l’ai un peu connu, mais c’était à Aden…
L’affaire n’eut pas de suite, malgré la bienveillance et l’empressement de ma chef de service préférée.
Le Rimbaud de Baba a existé. Il s’appelait Jean-Baptiste Rimbaud et travaillait aux Messageries Maritimes comme chef d’atelier (conductor) à Aden, Hedjuff, Little Pass, du temps de Rimbaud. L’homme aux semelles de vent signale cette homonymie dans l’un de ses courriers à sa mère « marque bien l’adresse pour qu’il n’y ait pas confusion » NDLR
Le train m’amena à Addis-Abeba, dans le centre de la ville, par temps gris.
Où était la maison Riès ? On m’avait dit qu’elle existait encore, qu’elle faisait du commerce….
Maurice Riès 1858-1945. Originaire de Marseille.
Arrive à Aden en 1876. Employé comptable de César Tian. Il deviendra son associé, et aussi celui de Rimbaud. (Riès était le fils de la femme de ménage de César Tian).
Commerce dans le café au Yémen.
Devient, également, en 1897, diplomate et agent consulaire à Aden.
Collaborera, commercera avec ses deux fils, Paul et Adolphe Riès jusqu’en 1920.
Ce sont eux qui ont repris l’affaire ? Il paraît qu’il faut chercher « Paul Riès § Sons, import-export ».
Riès séjournera quatre années à Hodeida pour fonder et diriger une succursale Tian (café).
Hodeida : Rimbaud, Trébuchet, Riès, Besse. La ville des petits français, aventuriers de passage.
Quand Rimbaud reprend connaissance, one leg left, il y a deux personnes à son chevet : sa mère….et Maurice Riès. Visite intéressée ou, simplement, de compassion mâtinée d’amitié ?
Un peu des deux mais chasser le naturel….amputé ou pas Rimbaud l’intéressait. Les affaires sont les affaires ! L’associé de Tian était venu pour apurer les affaires de l’Ardennais.
Aussi Vitalie Rimbaud se vit-elle offrir par Riès un magnifique chèque de trente mille francs, signé par Riès, « pour solde de tout compte », chèque qu’elle s’empressa d’aller toucher au CNEP Comptoir national d’Escompte de Paris ***
*** L’auteur de ces lignes a travaillé au CNEP de Reims en 1964-1965. Il se souvient que l’on parlait, alors, des actions sur les salines de Djibouti. Le temps a passé, les rives du lac Assal sont toujours gorgées de sel. Un miracle de beauté, bleu, blanc, vert, hors du temps, face à Bab el Mandeb, mais, ça, je vous l’ai déjà dit et redit. NDLR.
Laissons parler Riès :
« La famille Rimbaud : tous des rapaces, des gens méfiants. Pour le chèque, trente mille francs, c’était une petite fortune aussi, j’offris à Madame Rimbaud de l’accompagner à la banque. Refus de « la bouche d’ombre » qui quitta aussitôt Marseille.
Les affaires en règle Riès ne s’attardera pas dans la cité Phocéenne. Il revit une fois Rimbaud et sa sœur, à l’hôpital.
Laissons Riès égrener ses souvenirs.
« Rimbaud ? Oui, je l’ai connu à Marseille et à Aden. On a raconté des sornettes sur son compte. Il n’a jamais été pilleur d’épaves au Cap Gardafui.
Il n’avait pas bon caractère et ses relations avec son employeur, Bardey, étaient tendues. En 1888 Il avait demandé à Tian de devenir son agent au Harar.
On n’a jamais eu connaissance de son passé. Ni moi ni Bardey, ni Tian ni Monseigneur Jarosseau n’ont eu vent d’écrits, de poèmes de son temps Africain. À sa mort, en 1891, on n’a retrouvé, dans ses papiers laissés à Aden, que de la correspondance commerciale. Ces documents ont été brûlés, partis aux quatre vents.
Rimbaud ? On lui coupa la jambe le 27 mai 1891 dans l’hôpital de la Conception, boulevard Baille à Marseille.
Voilà l’histoire de Maurice Riès…..mais la piste pour raccrocher l’histoire aux Marill, Monfreid et, surtout, Besse, mon commanditaire ?
Les archives n’ont rien donné :
Archives du vice-consulat de France à Aden
Archives des affaires étrangères à Nantes
Archives militaires d’Aix en Provence
Archives anglaises, actions de Riès, agent consulaire de France à Aden
Les écoles chrétiennes où Riès fut étudiant
(1891 mort de Rimbaud.)
Riès, lui, simple employé, arrive en mer Rouge à 18 ans, devient patron d’un empire (comparable à celui de Besse). Par quel tour de passe-passe ?
Ses relations avec Rimbaud ? Ambigües. Avait-il peur que celui-ci ne prenne sa place chez Tian ?
1915 Riès aura à s’occuper, en tant que consul, de l’affaire Besse/Monfreid sur les trafics d’armes, deux commerçants français particulièrement retors.
Riès a-t-il fait passer sa réserve politique pour servir ses intérêts propres ?
Thésards, à vos plumes !
J’erre dans les rues d’Addis-Abeba.
Youssef me contacte :
« Vous perdez votre temps à Addis. Prenez les bonnes pistes :
Savon § Riès
Agence maritime
Cosignataire de navire transitaire. Fondé en 1950
Adresse : Boulevard Chick Osman Djibouti
Contact : Jean-Philippe Delarue.
Essayez d’obtenir, également, l’adresse du général Jean Maurin, en retraite à Djibouti. Il possède des documents de premier ordre.
Courage et salutations
Vous avez le bonjour des Marill
Je vais bien. Espère qu’il en est de même pour vous.
Qu’Allah vous protège.
Youssef
Bibliothèque de Djibouti
BOX P O 935 »
Djibouti, les frères Marill
Addis-Abeba, fausse route. Zigzag.
On reprend le train, le train des Chinois. On passe devant Diré-Dawa. De français il ne reste que l’alliance française, et des souvenirs en pagaille.
Du port de Djibouti, en face, on imagine Aden, comme un aimant, comme un diamant.
Alors, que fait-on ?
Les réponses, de suite, des correspondants :
Aden, Besse, Nizan. Épanchez-vous. Laissez tomber, pour l’instant, Riès, Tian.
Avez-vous les collections, les illustrations ? Où en est votre bouquin ? À Aden, Rimbaud se penche-t-il toujours à la terrasse de l’hôtel de l’Univers.
Je reviens à Aden
Je suis dans les bureaux de Besse et retrouve l’un des juristes Américains et Miss Cox.
Six mois ont passé.
Les palétuviers ont poussé.
Je n’avais pas prévenu de mon arrivée.
Il est midi.
Miss Cox me demande :
« Nous ne vous attendions pas. Comment allez-vous ? »
Le ton est distant, mais professionnel, courtois.
« Allons déjeuner à côté. J’ai des informations à vous communiquer. »
Nous nous installons au bar de la Mer Rouge, minuscule restaurant de quartier.
Elle mange, du bout des dents, elle, une salade, moi un poisson aux aromates d’Arabie.
Va-t-elle parler ? Elle trie dans son assiette, semblant écrire dans le plat avec sa fourchette.
Et, soudain, me regardant en face, elle se lance :
« Vous ne verrez plus Biscotte. On la retrouvée noyée au large de l’ile du diable ».
Elle a eu une aventure avec l’un de nos juristes Américains.
Elle leva ses beaux yeux bleu sur moi « Oui, vous avez dû le rencontrer. Un bel homme, enfin, pour celles qui aiment les hommes. Elle s’est jetée à sa tête, folle amoureuse de cet étalon pour jeune fille en fleurs. L’histoire a tourné court. En fait notre étalon était un trafiquant patenté et, surtout, un espion au service des forces Britanniques et de leurs colons. Espionnage politique doublé d’un espionnage industriel. Vous connaissez les concepts, relations et affaires de M. Besse.
Découvrant la vérité notre jeune fille en fleur se confie à M. Besse. Le bellâtre, démasqué, emmène Biscotte pour une promenade en mer et les requins ont eu à manger ce jour-là.
Des faits, dans leur crudité.
Ma lesbienne n’avait pas d’états d’âmes. Elle informait. Elle regrettait Biscotte, une belle fille au corsage bien rempli.
« M. Besse est à Hodeida, pour longtemps. Il m’a informé du contrat qui nous lie, la biographie, l’argent déjà versé et il m’a délégué tout pouvoir. Où en êtes-vous ? »
Elle me posait la question, la tête ailleurs, loin. Je ne l’intéressais pas mais elle demeurait scrupuleuse dans son travail.
Elle m’indiqua un des hôtels Besse « vous pouvez y demeurer le temps que vous voulez. Vous êtes notre invité, enfin, je veux dire, l’invité de M. Besse.
Demain arrive M. Paul Nizan, le précepteur français, un écrivain, engagé par M. Besse pour s’occuper de ses enfants. Passez dans les jours qui viennent, je vous le présenterai.
Miss Cox …. Fréquentait-elle les discrets clubs de femmes, entités secrètes pour femmes délaissées d’Aden, dont j’avais déjà eu des échos ? »
Elle avait à faire et m’abandonna sur un « Nous sommes content de vous revoir » plus conventionnel que chaleureux.
Ramassant mes affaires, je m’installe à « A l’Etoile d’Or », petit hôtel tranquille, avec jet d’eau dans le patio, tenu par un Maltais ; l’établissement ne contient que six chambres en enfilade.
Un commentaire sur “CHAPITRE 3 – Antonin Besse”
Les commentaires sont fermés.